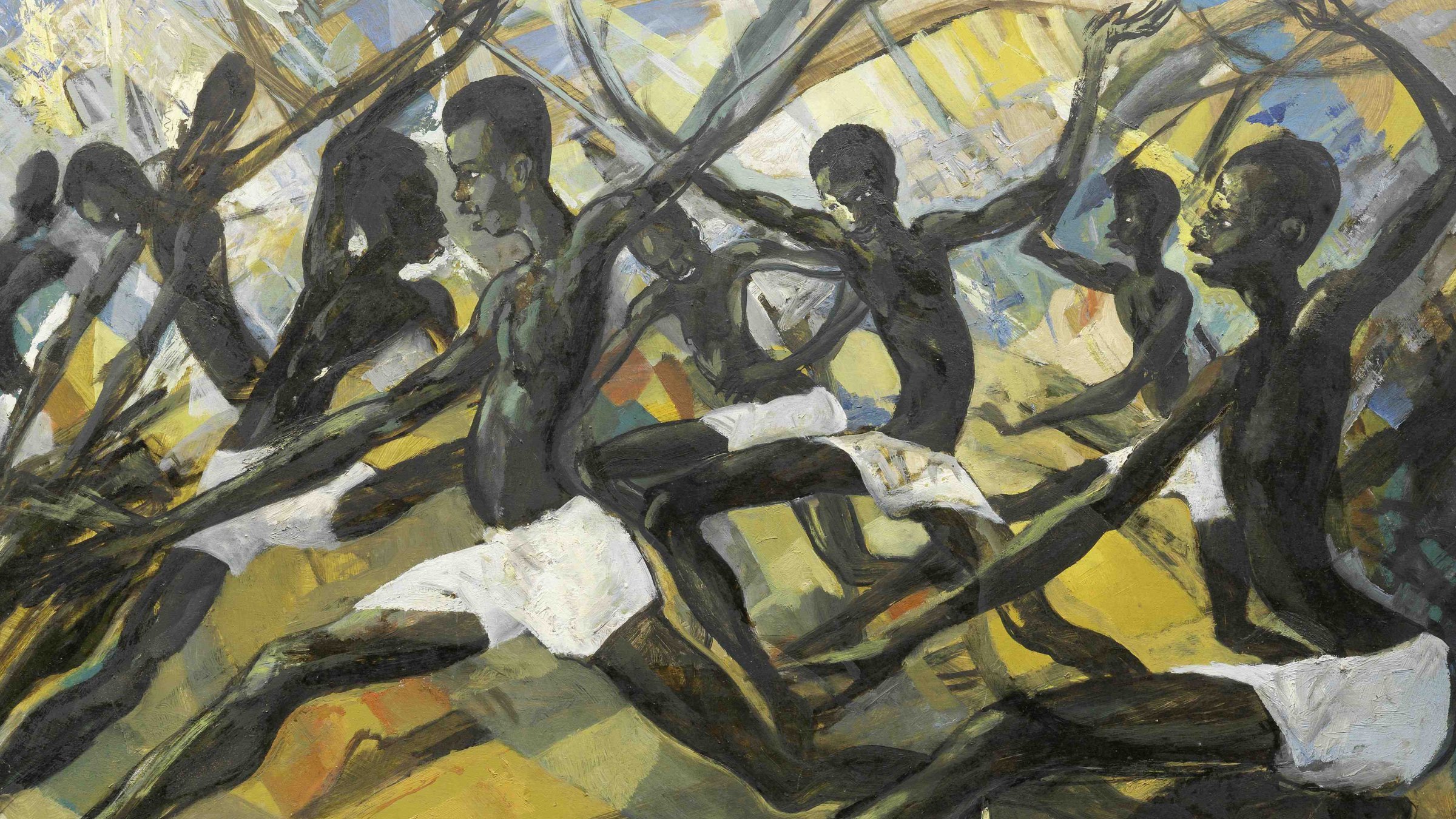
ÉDITO
Chères lectrices, chers lecteurs,
Avec plus de 20 000 euros recueillis, notre campagne de dons a dépassé la moitié de son objectif. MERCI.
Mais ce n’est pas suffisant. Le prochain objectif est de dépasser le deuxième palier de 30 000 euros d’ici au 5 décembre.
CHAQUE SEMAINE, vous êtes plusieurs milliers à recevoir notre lettre, gratuitement. Elle ne fait pas que recenser les articles de la semaine. Elle est enrichie d’un ou de plusieurs articles originaux (éditorial, papier d’actualité, recommandations de lecture…).
CHAQUE JOUR, vous êtes encore plus nombreux à lire les articles d’Afrique XXI proposés en accès libre.
UNE INFORMATION DE QUALITÉ A UN COÛT et exige du temps : elle est d’abord vérifiée, elle est recoupée, puis il faut la raconter, la mettre en scène, la corriger, l’éditer, l’illustrer... Elle nécessite de nombreux allers-retours entre l’auteurice et l’éditeurice avant d’être, enfin, publiée.
SANS VOTRE SOUTIEN, nous dépendrions soit d’actionnaires tout-puissants, soit de la publicité, ou des deux, et ne pourrions vous garantir l’indépendance de l’information.
C’est pourquoi une à deux fois par an nous vous sollicitons pour nous permettre de continuer à offrir cette information indépendante au plus grand nombre. Nous ne pourrions pas continuer sans votre soutien financier. Il est vital.
Merci.
Le comité éditorial d’Afrique XXI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
À VOIR
L’ÉCHEC DES NATIONS UNIES AU MALI FILMÉ EN IMMERSION
Onze ans de tournage, la défection d’un diffuseur télé en fin de processus : le film documentaire de Christophe Gargot, à l’instar de l’opération qu’il raconte dans Colombes sans gravité, a été laborieux dans sa fabrication. Mais le résultat est à la hauteur de son ambition : nous donner à voir, de l’intérieur, le processus politique et opérationnel qui a conduit à la mise en œuvre d’une des plus importantes opérations de paix jamais conduites dans le monde – avec un budget annuel de 1,2 milliard de dollars et l’engagement de 15 000 hommes, la Minusma a été l’une des missions les plus coûteuses et l’une des plus meurtrières, avec plus de 180 morts – et, dix ans plus tard, à un échec cuisant.

À travers des captations de l’Organisation des Nations unies – qui nous ramènent aux moments des arbitrages et aux illusions d’alors –, quelques archives vidéo de la Minusma, et, surtout, des entretiens avec des acteurs clés et des tournages embarqués avec les Casques bleus au Mali en 2016, 2018 et 2020, notamment dans les vastes étendues du Nord, le réalisateur nous fait vivre l’un des grands désastres onusiens de la dernière décennie.
Le ver était dans le fruit dès l’origine, disent, avec le recul, certains des personnages interviewés.
À cause, comme le dit l’ex-général Didier Castres, sous-chef d’état-major des opérations de 2011 à 2016, d’un modèle d’intervention de paix « prêt-à-porter » inadapté : « La plupart du temps, on a une espèce de solution toute faite importée de crises passées – que d’ailleurs [elle n’a] pas réussi à résoudre – qui consiste à : un, on intervient militairement, on sépare les belligérants, on élimine celui qui était le plus dangereux ou on égalise les capacités des uns et des autres, deux ; on va vers des élections parce qu’on dit que la démocratie c’est bien […] donc il faut faire des élections ; trois, on crée une mission des Nations unies ; quatre, on crée une mission de l’Union européenne pour la formation, et on dit qu’on a résolu la crise. Or on n’a rien résolu. Tout ça c’est du prêt-à- porter. Or, sur les crises, il faut faire du sur-mesure."
En 2013, à la tribune des Nations unies, le représentant permanent de la France aux Nations unies, Gérard Araud, défendait justement ce modèle : « ne opération de maintien de la paix accompagnée d’une mission technique européenne », et il promettait le retrait de la première « quand l’armée nationale pourra faire le travail ».
D’ailleurs, le débat faisait rage à l’intérieur de l’organisation, y compris dans l’entourage du secrétaire général d’alors, Ban Ki-moon, se souvient Bert Koenders, représentant spécial de l’ONU au Mali de 2013 à 2015, entre ceux qui étaient favorables à une action militaire des Nations unies à côté de forces françaises – option défendue par le département Maintien de la paix – et ceux qui estimaient, notamment au département des Affaires politiques, qu’il fallait plutôt engager « une mission politique concentrée sur ce que les Nations unies font le mieux : la médiation, le processus de paix et l’humanitaire ». « Le département Maintien de la paix a remporté cette bataille avec le soutien du secrétaire général et la majorité du Conseil de sécurité, puisqu’il y avait encore, à cette époque, un consensus, qui n’existe plus », raconte le diplomate néerlandais, ancien ministre des Affaires étrangères.
En arrière-plan de l’échec aussi, une articulation impossible avec l’engagement militaire français, bien expliquée par Koenders : « Une force était l’instrument de l’autre. Le gouvernement français avait pris la responsabilité [d’aider les autorités maliennes à reprendre le contrôle du territoire] mais il savait qu’il ne pouvait pas le faire seul. » Ou Gérard Araud, a posteriori, qui avoue avoir été « sceptique depuis le début » sur la capacité des forces de maintien de la paix à conduire « un mandat très énergique » sans être équipées pour cela, avec un armement léger et « sans motivation réelle et sans chaîne de commandement ». Les Casques bleus avaient déjà fort à faire pour se protéger eux-mêmes et n’étaient pas en capacité d’affronter militairement les djihadistes, malgré de lourdes pertes dans leurs rangs.
Désarmement, démobilisation, réintégration, les trois piliers des opérations de paix, ont pourtant été mis en œuvre au Mali par des fonctionnaires internationaux dévoués à leur mission sur le terrain, qu’on voit dans le documentaire, tel que ce Pakistanais, chef d’équipe à Gao du programme DDR. Ou les soldats anonymes venus déminer les abords du camp et patrouiller en terre hostile. Le film montre aussi un bataillon reconstitué, l’unité avortée portée par tant d’espoirs, enrôlant sous le drapeau national des combattants de tous bords et de toutes allures contre les djihadistes des régions reculées. Les bataillons reconstitués furent pris pour cible, dès leur naissance, par Al Qaida au Sahel, à travers de sanglantes attaques kamikazes, comme celle de Gao, le 18 janvier 2017 (60 morts). On voit à nouveau l’énergie diplomatique misée sur l’accord de paix dit d’Alger, torpillé, malgré ses engagements publics, par le défunt président Ibrahim Boubacar Keïta sur l’autel de la reconnaissance de l’Azawad, à laquelle il ne pouvait se résoudre.
Koenders rappelle combien « tous les pays de la région – Algérie, Maroc, Mauritanie, Burkina Faso... – font partie du problème et de la solution », dans leurs rivalités de leadership. Moussa Ag Acharatoumane, le chef du Mouvement pour le salut de l’Azawad, ajoute la Libye à la liste. Gérard Araud va un peu plus loin, explorant les frustrations croisées de l’Algérie, qui « considérait le Mali comme son arrière-cour et manifestait une absence d’enthousiasme de voir des soldats français s’installer » et repousser les djihadistes vers le nord, et du Maroc, « dont les frontières ont été tracées par (la France coloniale) en 1956 au profit de l’Algérie française » et qui revendiquait une légitimité d’influence jusqu’à Tombouctou.
La fin du film, on la connaît déjà. Coups d’État, arrivée de régimes hostiles à la France et à la communauté internationale en général, rapprochement diplomatique et militaire avec la Russie. Et, surtout, montée en puissance des groupes armés djihadistes reconnue avec honnêteté par Gérard Araud : « Quand nous arrivons, en 2013, il n’y a pas de djihadistes au Niger, pas de djihadistes au Burkina Faso, et aujourd’hui il y en a partout. Ces pays africains peuvent au minimum dire : “depuis que vous êtes intervenus, la situation s’est aggravée pour nous”, et comme nous vivons dans le monde du complot, ils en arrivent à dire : “c’est parce que vous vous entendez avec les terroristes”. On en arrive à cette absurdité. »
À voir : Christophe Gargot, Colombes sans gravité, (2025), 86 minutes. Projection au Christine Cinéma, 4, rue Christine, Paris 6e, 2 décembre 2025 à 20h15.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
DANS L’AGENDA
ABDOURAHMAN WABERI DANS HORIZONS XXI LE 3 DÉCEMBRE

Écrivain et intellectuel, homme de gauche « d’ici et d’ailleurs », Abdourahman Waberi, membre du comité éditorial d’Afrique XXI, arpente la planète, de Djibouti où il est né à une époque où ce pays de la Corne d’Afrique était encore une colonie française, en passant par la France, l’Allemagne, la Suisse ou encore les États-Unis. Dans son Autoportrait avec Mélenchon, l’homme qui a sauvé la gauche (Le Bord de l’eau), il raconte son cheminement politique personnel, fait de désillusions mais aussi, et surtout, d’un nouvel élan grâce à sa rencontre avec La France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon.
Nous le recevons Au Poste dans notre émission Horizons XXI (les épisodes précédents disponibles ici), le 3 décembre à 18 heures, en direct (puis disponible en streaming).
_ _ _ _ _ _ _ _ _
SUR NOS ÉCRANS RADARS
L’ÉTAT MALIEN A-T-IL GAGNÉ SON BRAS DE FER CONTRE LE GÉANT MINIER BARRICK ?
L’État malien et Barrick Gold ont annoncé lundi avoir trouvé un accord pour relancer l’exploitation de la plus grande mine d’or du pays, à Loulo-Gounkoto, dans l’Ouest, suspendue depuis janvier. Les clauses de cet accord ne sont pas toutes connues, mais, selon Bloomberg, Barrick a accepté de verser 430 millions de dollars à Bamako. Cette somme pourrait correspondre aux arriérés d’impôts réclamés par le Mali et que la compagnie canadienne refusait de payer, à la suite de la modification du code minier, en 2023.
Comme l’expliquait le chercheur Guillaume Bagayoko en février dernier, la junte malienne cherche à « rompre avec l’ordre libéral » pour augmenter les recettes tirées du secteur minier, dont elle estimait les réglementations trop favorables aux multinationales étrangères.
À (re)lire : Mali. L’État rompt avec l’ordre libéral dans les mines industrielles
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LES ARTICLES DE LA SEMAINE
Ce que la France doit au Niger
Analyse Un groupe de communautés du Niger a engagé auprès des Nations unies une procédure en réparation pour les crimes commis par la France en 1899 lors de la conquête coloniale. Malgré la promesse française d’ouverture au dialogue bilatéral, le chemin risque d’être très long dans le contexte de rupture entre les deux pays.
Par Rob Lemkin
NIGERIA. LE BLUES DE L’OR NOIR
Bodo. Les cicatrices toujours ouvertes du delta du Niger
Série 2/3 Dans le sud-est du Nigeria, les marées noires passées ont saccagé le sol et l’eau. Près de deux décennies plus tard, le coûteux plan de dépollution adopté sur recommandation des Nations unies n’a pas achevé sa mission, tandis que la contamination se poursuit.
Par Marco Simoncelli, Davide Lemmi et Lorenzo Bagnoli
RD Congo. La famille Tshisekedi dans le collimateur de la justice belge
Enquête Des syndicats et des ONG de la région minière du Katanga, dans le sud du pays, sont venus déposer une plainte à Bruxelles pour des faits présumés de détournement et de blanchiment de fonds captés par des hauts responsables congolais, dont des membres de la famille présidentielle..
Par Colette Braeckman
Guinée-Bissau. « Embaló a une conception autoritaire du pouvoir »
Entretien Les Bissau-Guinéens sont appelés aux urnes le dimanche 23 novembre. Bubacar Turé, le président de la Ligue guinéenne des droits humains (LGDH), s’inquiète d’une situation dégradée dans le pays, que ce soit dans le domaine des droits humains ou sur le plan politique.
Par Tangi Bihan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IN ENGLISH
Sudan. In El Fasher, “We Live with the Stench of Blood and Death.”
Testimony On 26 October, the capital of North Darfur fell to the Rapid Support Forces (RSF) after an eighteen-month siege. In the hours following the city’s fall, thousands of civilians were executed. Three weeks after the massacres, the focus seems to be on continuing the war more than on negotiations (by Orient XXI).
By Eliott Brachet
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
