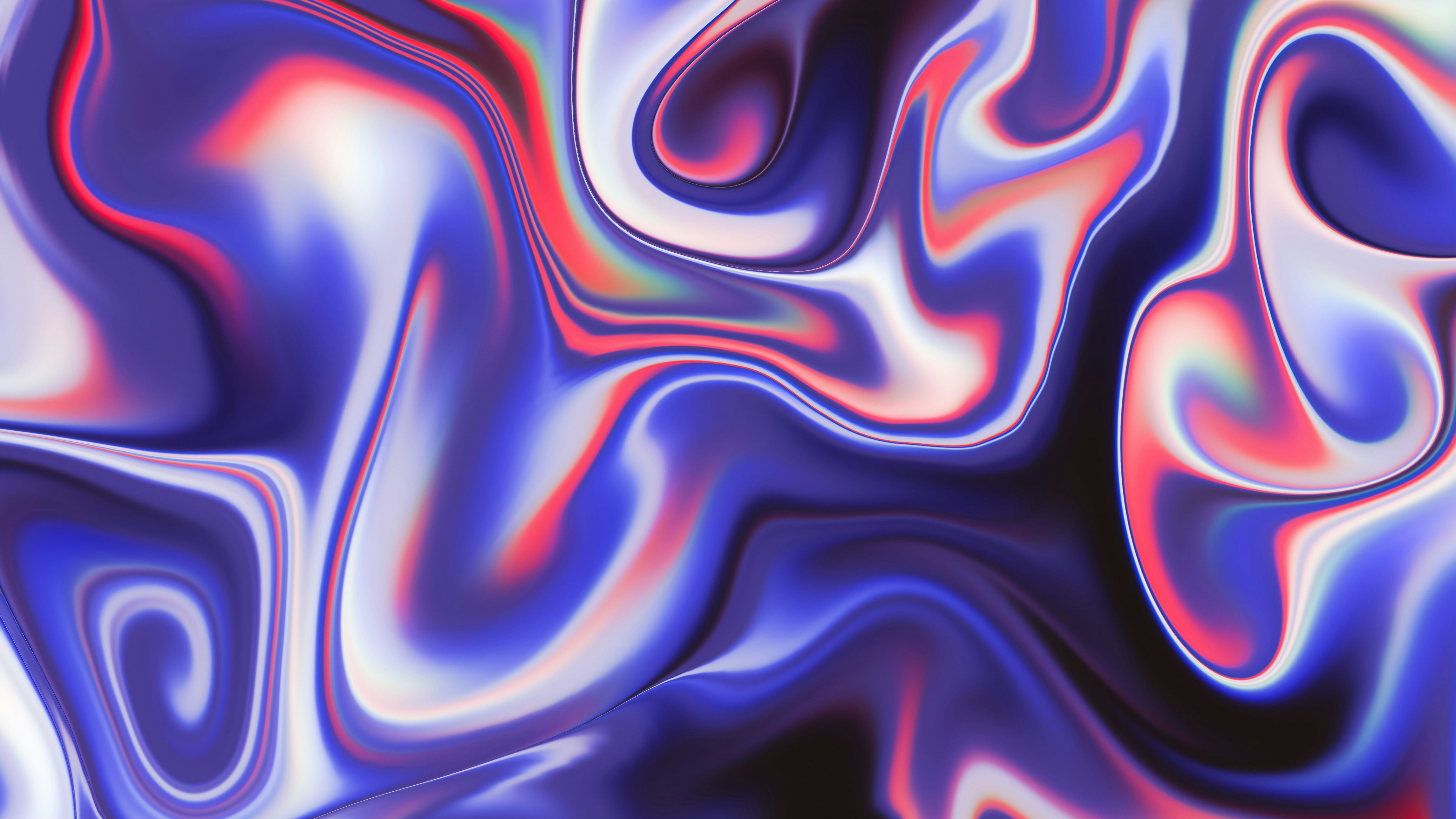
ÉDITO
L’IA N’EST NI « ÉTHIQUE » NI « INCLUSIVE »
C’est toujours la même histoire du capitalisme qui se répète, encore et encore. Et ce n’est que le début (d’accord, d’accord). Lors du Sommet de Paris pour l’action sur l’intelligence artificielle (IA), sous les ors de la République (le Grand Palais à Paris), celui qui se voit comme le patron de la « start up nation » s’est félicité, sans recul ni discernement, des promesses (principalement saoudienne et indienne) d’investissement de dizaines de milliards d’euros pour permettre à la France et à l’Europe de rivaliser avec la Chine et les États-Unis dans leur course effrénée à l’intelligence artificielle.
Emmanuel Macron a salué la signature, le 11 février, en clôture du sommet, par 61 pays (sans les États-Unis et sans l’Angleterre) d’une déclaration en faveur d’une IA « ouverte », « inclusive » et « éthique ». Parmi les objectifs affichés, « rendre l’intelligence artificielle durable pour les populations et la planète »… Pour Macron, abscons, il s’agit de délivrer « les clés de la confiance ». Ces éléments de langage résonnent comme les mantras d’Elon Musk, Jeff Bezos et Marc Zuckerberg.
Il ne manquait plus que la mention de l’Afrique pour compléter cette opération de communication bien huilée. L’Agence française de développement (AFD) y a veillé : elle a multiplié les communiqués de presse appelant, par exemple, à « un avenir durable et inclusif ». L’organisme, critiqué pour certaines de ses actions sur le continent (comme en RD Congo), estime que « l’IA s’impose comme une réponse aux défis sociaux, économiques et environnementaux majeurs de l’Afrique ».
L’Afrique sera bien un acteur essentiel dans cette course. Et elle l’est déjà. Mais très loin des clichés de l’IA « éthique » et « inclusive ». Sa croissance est alimentée par des petites mains payées au lance-pierre : ces « annotateurs » et « étiqueteurs » de données sont malgaches ou kényans et travaillent dans des conditions misérables. À Madagascar, l’un de ces forçats du numérique disait à France Télévisions gagner 6 centimes de dollar par tâche. « Il faut qu’il en réalise plus de 300 pour espérer gagner 20 euros », rappelait en avril 2024 le journaliste dans ce reportage.
Au Kenya, où les conditions sont à peu près les mêmes, des travailleurs ont déposé une pétition auprès du Parlement pour demander une meilleure protection de leurs droits. « Nous demandons une paie équitable, des conditions de travail raisonnables et un soutien psychologique adéquat. C’est le strict minimum en comparaison des millions que ces entreprises gagnent grâce aux innovations auxquelles nous participons », a expliqué l’un d’eux à RFI.
Le continent est également la réserve principale des minerais nécessaires à la production de cette IA. Là, dans les mines de cobalt par exemple, la magie de cette « intelligence » n’a pas cours. Le travail des enfants, le pillage en règle, les conflits armés se perpétuent depuis trente ans dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Ce néocapitalisme n’a pas d’éthique et il n’est certainement pas inclusif. Il exploite et tue les Africains.
La guerre en cours dans l’est de la RD Congo a des racines historiques et politiques multiples mais la course aux minerais en est l’une des causes. Les multinationales de la tech prospèrent sur des charniers et ne redistribuent presque rien des centaines de milliards de dollars engrangés au mépris des vies congolaises. Si la RD Congo a porté plainte contre plusieurs d’entre elles en France et en Belgique, l’engouement suscité par la grande fête macroniste n’a pas dû rassurer son dirigeant, Félix Tshisekedi : quelques rares voix se sont élevées pour demander au président français d’aborder la question du soutien du Rwanda au M23, le groupe armé qui a pris la ville de Goma fin janvier (au moins 3 000 morts selon l’ONU) et qui continue son avancée dans le Sud-Kivu, mettant au passage la main sur des mines stratégiques. Un appel en vain.
Face à ces drames humains, dont l’industrie de l’IA est l’une des responsables, les centaines de milliards annoncées dans une euphorie béate ont quelque chose d’indécent et de cynique. C’est peut-être la vertu principale de l’IA pour ses adeptes : proposer un récit alternatif et mensonger de notre monde, promu par des hérauts libéraux décomplexés.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
À LIRE
TOUT SAVOIR SUR LE « CAPITALISME RACIAL »
Le dernier numéro de la revue Marronnages (qui passe « au crible des sciences sociales » les questions raciales) s’intéresse au « capitalisme racial ». Les auteurs, dont Lionel Zevounou (l’un des deux rédacteurs en chef de Marronnages et membre du comité éditorial d’Afrique XXI), ont souhaité « donner de la consistance [à cette notion] dans le monde francophone pour montrer l’aspect des hiérarchies et des inégalités raciales qui persistent dans le Sud et en Occident », alors que le capitalisme s’y est largement déployé et était censé gommer ces inégalités.
En effet, les auteurs sont partis des travaux de Cedric Robinson, auteur de « Black Marxism » (Zed Books, 1983, traduit en français en 2023 chez Entremonde sous le titre de Marxisme noir. La genèse de la tradition radicale noire). Dans cet ouvrage, Robinson reproche notamment à Marx d’avoir sous-estimé la hiérarchisation raciale au sein de la classe ouvrière.
Le capitalisme racial avait déjà été étudié par la gauche sud-africaine durant l’apartheid, précise Lionel Zevounou. « Les libéraux sud-africains affirmaient que le racisme et l’apartheid tomberaient grâce au capitalisme, explique-t-il. Les marxistes n’étaient pas d’accord. » L’histoire le prouve : le capitalisme s’est très bien accommodé des inégalités raciales. Il en a même joué. Ce débat a d’ailleurs ressurgi avec le mouvement Black Live Matters en 2013.
Parmi les articles de ce numéro, l’entretien entre les historiennes Madeline Woker et Muriam Haleh Davis est particulièrement riche. Professeure associée à l’université de Californie-Santa Cruz, Muriam Haleh Davis est l’autrice de Markets of Civilization : Islam and Racial Capitalism in Algeria (Duke University Press, 2022 ; non traduit en français). Dans Marronnages, elle rappelle notamment que son ouvrage est « une sorte de “préhistoire” montrant comment un système capitaliste fondé sur des idées raciales a été mis en place entre la conquête de l’Algérie, en 1830, et la Grande Guerre ».
Et, alors que 2025 est l’année des cent ans de la naissance de Franz Fanon, elle ajoute que « [Le] constat [de Franz Fanon] qu’il fallait élargir la pensée marxiste et qu’“aux colonies, l’infrastructure économique est également superstructure et la cause, conséquence : on est riche parce que blanc, on est blanc parce que riche” est fondamental pour comprendre comment la pensée raciale fabrique la vie économique. »
À lire : « Capitalisme racial ? », Marronnages, volume 3, n° 1, 29 novembre 2024. Numéro en PDF à télécharger ici
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LES ARTICLES DE LA SEMAINE
Cameroun. La radicalisation des loyautés au cœur de la guerre anglophone
Bonnes feuilles Le dernier ouvrage de la politiste Marie-Emmanuelle Pommerolle s’intéresse à l’ordre politique camerounais. « De quoi est-il fait ? », s’interroge-t-elle en explorant, à travers la notion de « loyauté », la pratique électorale, les rapports diplomatiques, le fonctionnement de la société civile ou encore l’évolution du conflit armé dans les régions anglophones.
Par Marie-Emmanuelle Pommerolle
L’étonnante postérité de la doctrine française de contre-insurrection
Entretien L’historien britannique Terrence Peterson raconte dans un livre, sur la base de nombreuses archives, la « pacification » conduite par l’armée française en Algérie pour tenter d’effacer le désastre indochinois de Diên Biên Phu en 1954. Une méthode qui inspirera durablement d’autres armées, dont le Portugal et les États-Unis.
Par Victoria Brittain
Kenya. Malgré les disparitions forcées, la Gen Z continue de défier William Ruto
Reportage Incarné par une jeunesse qui remet en cause l’establishment kényan, le mouvement lancé en juin 2024 a trouvé d’autres plateformes pour s’exprimer, notamment sur internet. Une mobilisation qui n’est pas sans risque : plus de 80 activistes sont portées disparues depuis le début des manifestations.
Par Maina Waruru
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
In English
Kenya. Despite enforced disappearances, Generation Z continues to challenge William Ruto
Embodied by young people who are challenging the Kenyan establishment, the movement launched in June 2024 has found other platforms to express itself, particularly on the internet. This mobilisation is not without risk : more than 80 activists have been reported missing since the protests began.
By Maina Waruru
Vous aimez notre travail ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
