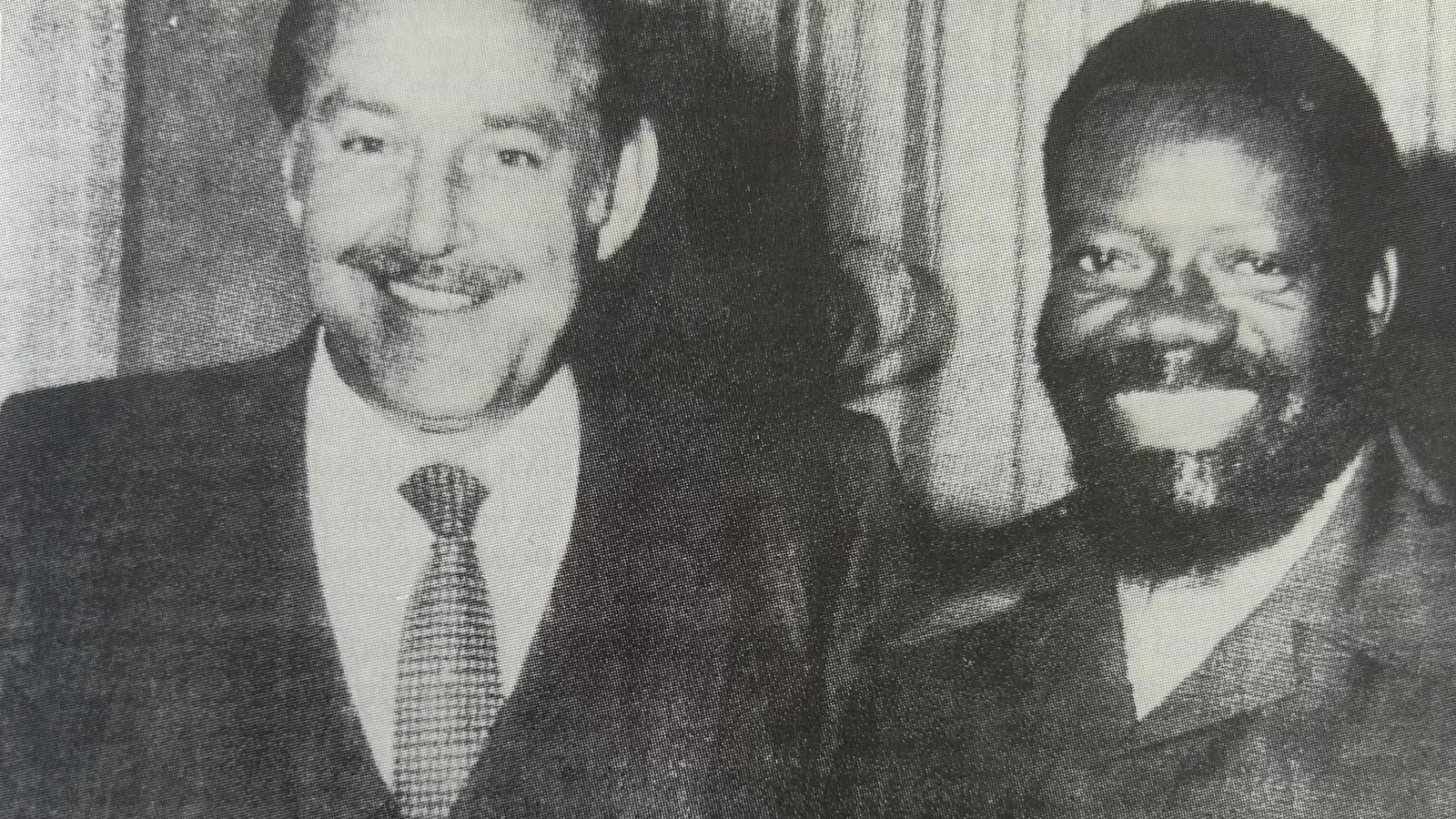
L’histoire est connue : le 22 février 1974, le général portugais António de Spínola publie Le Portugal et son avenir1, un livre mettant en cause la politique coloniale de Lisbonne. Ce « champion » des guerres en Afrique, appelé peu avant cette publication par le Premier ministre, Marcelo Caetano, à moderniser l’armée afin de permettre une intensification de l’effort militaire, était arrivé à la conclusion paradoxale suivante : « Prétendre vaincre militairement la subversion, c’est courir à la défaite. »
Son supérieur hiérarchique, le général Costa Gomes, le soutient dans une lettre adressée au ministre de la Défense nationale, Silva Cunha : « Le général Spínola rend ainsi des services considérables et aussi brillants que ceux qu’il a rendus sur les champs de bataille », écrit-il. Le général Spínola se présente comme l’homme qui, de longue date, se prépare à « sauver le Portugal et son empire », et dont le but ultime serait la mise sur pied d’un Commonwealth « lusitanien », c’est-à-dire l’indépendance des « provinces d’outre-mer » sous la houlette du Portugal et dont les colons seraient aussi (ou surtout ?) les bénéficiaires.
Caetano ne paraît pas trop inquiet à la lecture de ce livre. À la veille de sa parution, il affirme que les thèses fédéralistes sont inappropriées : « Si le pouvoir passe aux mains des terroristes, déclare-t-il, ils expulseront immédiatement tous les Blancs résidant en Afrique. » Caetano admet cependant que « ce projet aurait été réalisable au début des années 1960, à une époque où les mouvements de subversion étaient encore faibles ». Caetano se déclare favorable à une société multiraciale, qui est en gestation mais encore trop fragile pour se maintenir toute seule. En revanche, il se montre très dur pour les « ultras », qui, dit-il, « confondent patriotisme et politique d’intégration en Afrique ».
« Une guerre impossible à gagner »
Le Premier ministre n’a pas oublié la tentative de coup d’État de décembre 1973, dirigée par le général Kaúlza de Arriaga avec la caution du chef d’état-major d’alors, ce qui a valu à Spínola d’accéder au poste de chef d’état-major adjoint, avec pour mission de purger l’armée des ultras hostiles à Caetano. Kaúlza de Arriaga fut également l’organisateur de l’expédition maritime contre la Guinée-Conakry en novembre 1970, dont le but était de renverser le pouvoir de Sékou Touré et d’attaquer la principale base du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) hors de la Guinée-Bissau, qui s’est soldée par un retentissant échec.
Mais l’armée est parcourue d’autres remous. À partir du Mozambique, un groupe d’officiers diffuse à Lisbonne un manifeste dans lequel ils déclarent refuser de devenir « des boucs émissaires d’une guerre impossible à gagner ». Certains de ces rebelles ont fait « la sale guerre de Guinée » avec Spínola, mais leurs revendications vont plus loin que celles du général. Début mars, une centaine d’officiers, dont plusieurs capitaines, signent un manifeste réclamant « une solution politique » à la colonisation. Ce mouvement prend de plus en plus ses distances avec Spínola.
Les ultras, réunis autour du président, l’amiral Américo Tómaz (1958-1974), exigent, pour commencer, le limogeage des généraux Spínola et Costa Gomes, responsables selon eux de l’indiscipline des officiers. Caetano hésite mais doit s’appuyer sur les ultras pour enrayer la contestation. Le 5 mars 1974, il affirme à l’Assemblée nationale que le Portugal « restera en Afrique, quel que soit le prix à payer ». Le lendemain, Kaúlza de Arriaga, prétendant à la succession de Caetano, rentre d’Afrique du Sud avec le général Luz Cunha, chef du corps expéditionnaire d’Angola, et élabore un plan pour mettre fin à « la subversion communiste au sein de l’armée ». L’agitation est grande dans les rangs de l’armée, l’état d’urgence est proclamé. Les capitaines réagissent en exigeant le départ du ministre de la Défense.
Espace atlantique « légitime »
Le 13 mars 1974, un conseil de guerre est organisé : le chef de l’État exige finalement le limogeage des généraux Spínola et Costa Gomes. Le lendemain, les chefs des trois armées assurent Caetano de leur loyauté. Absents de cette réunion, Spínola et Costa Gomes sont démis de leurs fonctions dans l’après-midi. Les faucons, dont le général de Arriaga, prennent le pouvoir. Le 15 mars, l’alerte est maximale. Le 16, une centaine d’officiers, sous-officiers et soldats décident de marcher sur Lisbonne mais sont arrêtés aux portes de la capitale. Au même moment, le Front de libération du Mozambique (Frelimo) fait une importante percée vers le sud du Mozambique. Le gouvernement de Lisbonne annonce aussitôt la décision d’envoyer 10 000 hommes dans cette colonie.
Après des jours de préparatifs aussi discrets qu’efficaces, le Mouvement des forces armées (MFA), avec à sa tête les généraux António de Spínola et Costa Gomes, prend le pouvoir. La popularité du MFA est immédiate. La fin de cinquante ans de pouvoir fasciste a sonné. Les premières déclarations sur la politique à l’égard des colonies sont cependant minimalistes : « La question coloniale ne peut pas être résolue par des voies militaires mais politiques. » Le mot « indépendance » n’est pas encore prononcé.
Quelques semaines plus tard, des négociations sont toutefois engagées avec le PAIGC. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Mário Soares, chef du Parti socialiste rentré d’exil, est mandaté pour négocier avec le mouvement indépendantiste de la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert. Des tentatives pour séparer le cas de ces deux colonies sont dans l’air... Si le PAIGC a déclaré son indépendance dès septembre 1973 – l’année au cours de laquelle fut assassiné son leader, Amílcar Cabral –, aussitôt reconnue par 67 pays, une partie du nouveau régime portugais pense encore pouvoir maintenir l’archipel sous son contrôle en le revendiquant comme faisant partie de son espace atlantique « légitime ». Vaine tentative.
En dépit de quelques tensions, les pourparlers avec le Mozambique, facilités par l’indiscutable représentativité du Frelimo en tant qu’unique mouvement de libération reconnu internationalement, avancent, et, en dépit de quelques bruyantes manifestations des colons portugais sur place, un accord est signé le 7 septembre 1974 à Lusaka entre le représentant du Portugal et le président du Frelimo, Samora Machel. L’indépendance du Mozambique a désormais une date : le 25 juin 1975.
L’Unita, agence de renseignement
Le cas de l’Angola est plus complexe. Si, jusqu’au 25 avril 1974, seulement deux mouvements de libération angolais sont reconnus par l’Organisation de l’unité africaine (OUA), le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) d’Agostinho Neto et le Front national de libération de l’Angola (FNLA) de Holden Roberto, quelques mois plus tard, l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (Unita) de Jonas Savimbi va obtenir le même statut : celui d’un mouvement de libération pouvant être admis aux négociations pour l’indépendance. Pourtant, l’OUA n’a jamais été sollicitée pour approuver un tel état de fait, dont la véracité est censée être vérifiée au cours de visites sur le terrain par des militaires africains chevronnés et dans le cadre de rencontres avec les divers échelons des forces combattantes.
En réalité, le mouvement des forces armées au cœur de la révolution portugaise d’avril est divisé sur le sujet. Les éléments influents de l’aile progressiste, dirigée par le général Vasco Gonçalves, qui deviendra Premier ministre de quatre des gouvernements provisoires de l’après-25-avril, juge inopportun d’offrir le statut de mouvement de libération à une organisation, l’Unita, ayant étroitement collaboré, et cela de sa propre initiative, avec l’armée portugaise en Angola dans le but de combattre les deux autres mouvements.
Pour s’assurer de la solidité des accords de bonne entente et de collaboration entre son mouvement et l’armée portugaise, Jonas Savimbi, le leader de l’Unita, avait même souhaité obtenir la formalisation de cette coopération par le biais d’un pacte écrit entre son organisation et les plus hauts échelons de l’armée. Ce fut chose faite le 7 novembre 1972 : le document « Operaçao madeira » fut dûment signé dans la brousse de la province de Moxico (est de l’Angola) par le plus haut représentant de l’armée portugaise, le général Costa Gomes, qui deviendra le premier chef d’État post-fasciste.
Une collaboration qui a duré quatre ans
Dans sa biographie2, l’ancien président portugais reconnaît avoir donné son aval à cet accord, négocié par le général Bettencourt Rodrigues, commandant de la zone Est, et d’y avoir personnellement souscrit avec le but principal « d’obtenir de l’Unita des informations sur les plans d’actions du MPLA [que les hommes de Savimbi se proposaient d’espionner, NDLR], ainsi que sur le positionnement de ses bases, afin d’en informer le commandement de l’armée portugaise en Angola ». Le directeur de la Direction générale la sécurité (DGS) en Angola, Sao José Lopes, cité par le biographe officiel de Costa Gomes, « avait souhaité que le gouverneur-général noue une relation des plus étroites avec l’Unita ». Le gouvernement portugais en avait été informé, et le ministre de l’Outre-Mer, Silva Cunha, avait jugé « les initiatives pour une éventuelle collaboration avec l’Unita contre l’UPA-FNLA et le MPLA du plus grand intérêt ».
Le plan de cette opération prévoit par ailleurs « l’attribution à Jonas Savimbi d’une fonction administrative en Angola », ainsi que « l’intégration des troupes de l’Unita dans les forces portugaises ». Cette collaboration va durer de 1969 à la fin de 1973. Elle est interrompue par le nouveau commandement de l’armée d’occupation dans l’est de l’Angola, le général Abel Hipólito, pour qui le concours de l’Unita à la « pacification » de la colonie est inefficace, voire déshonorant pour l’armée. Pendant cette période, les quelque 200 à 300 hommes en armes de l’Unita, selon les rapports de l’armée portugaise, étaient ravitaillés pour satisfaire leurs besoins en armes, munitions, alimentation, médicaments, uniformes, etc., par l’armée d’occupation avec le concours de colons portugais installés dans la région orientale de Moxico pour en exploiter le bois.
Une collaboration à l’initiative de Jonas Savimbi
L’armée portugaise en est arrivée à garantir à l’Unita sa protection pour l’organisation en toute sécurité de son troisième congrès de 1973 dans les régions du sud-est de l’Angola, y compris pour assurer l’acheminement des participants dudit congrès, venant de la Zambie voisine, selon le récit de l’officier de liaison Benjamin Almeida3. Les thèses de ce congrès de l’Unita, aussitôt publiées, sont pourtant interprétées par des observateurs et des journalistes internationaux comme étant la démonstration du fort penchant « maoïste » de l’Unita, dont cette dernière aime se targuer.
Quelques semaines après la révolution portugaise du 25 avril 1974, les officiers du cercle du général Vasco Gonçalves livrent à Aquino de Bragança, un intellectuel et journaliste originaire de l’île de Goa, engagé dans la lutte de libération auprès du Frelimo, une riche documentation au sujet de cette extraordinaire collaboration. Dans ce document, on apprend que c’est Savimbi lui-même qui, le 3 mars 1969, soit une année et demie après la création de l’Unita en territoire angolais, avait pris l’initiative d’adresser une longue lettre au gouverneur de l’Angola. Il lui écrivait qu’il souhaitait traiter directement avec cette entité « civile », et non pas (ou plus ?) avec la police politique portugaise (Pide). Peut-être que cette dernière n’avait pas apprécié le double jeu de Savimbi, qui se présentait à l’étranger comme le plus radical des opposants à la brutale colonisation… En tout cas, la Pide, devenue DGS, va suivre de près la collaboration de l’Unita avec l’armée portugaise, comme en témoigne l’ample dossier fourni par les officiers portugais – dont les copies sont toujours disponibles.
Le bimensuel tiers-mondiste français Afrique-Asie, auquel collabore Aquino, publie en juillet 1974, et en première mondiale, des morceaux choisis de l’étonnante correspondance de Savimbi avec les autorités coloniales et le commandement de l’armée d’occupation. Bien entendu, la presse portugaise va également s’y intéresser quelques temps après. Et les années suivantes, plusieurs livres seront publiés en portugais, et également en anglais, décrivant cette relation incestueuse.
En France, les éditeurs ont plutôt penché en faveur d’auteurs qui n’ont pas seulement ignoré les compromissions de Savimbi, mais qui ne tarissaient pas de louanges sur l’héroïque combattant, présenté comme « le de Gaulle africain »4 : Portrait d’un révolutionnaire en général : Jonas Savimbi5, ou encore Savimbi, demain la liberté6… Les livres les plus fiables, avec un écho international, sont le fait d’historiens et de journalistes en majorité états-uniens et britanniques (tels Basil Davidson ou William Minter).
Le MPLA et le FNLA dans une guerre fratricide
La nouvelle génération de chercheurs et d’« africanistes » français et européens ne mentionne nullement, ou plus, cette extraordinaire collaboration, et certains d’entre eux ne montrent aucun intérêt à consulter les archives à ce sujet. Pourtant, l’abondante correspondance de Savimbi, qui révèle qu’il a informé le commandement de l’armée portugaise des mouvements des autres organisations, principalement le MPLA, est une source inépuisable des vues de cet Angolais hors normes sur de nombreux sujets. Il lui arrivait aussi d’affirmer que le peuple angolais n’était pas mûr pour l’indépendance… Cette étonnante alliance n’a pas été un égarement momentané, comme certains ont écrit, ni un passage à vide éphémère, mais une stratégie consciente et sans scrupules. Voire une « curiosité », car on ne connaît pas de cas comparables dans l’histoire du XXe siècle africain.
Quoi qu’il en soit, les révélations sur la collaboration avec les autorités coloniales n’ont pas empêché l’Unita de revêtir le rôle de troisième force ayant lutté pour l’indépendance de l’Angola, condition indispensable à sa participation aux négociations avec la puissance coloniale. En effet, la composante progressiste du MFA s’est pliée aux arguments des meilleurs connaisseurs du contexte angolais en son sein, tel l’amiral Rosa Coutinho. Ce dernier craignait un face-à-face mortel entre le MPLA et le FNLA pendant la phase de transition qui allait précéder l’indépendance (signée en janvier 1975). Ces craintes étaient justifiées car le FNLA, soutenu par le Zaïre de Mobutu Sese Seko et par les États-Unis, comptait déjà dans son tableau de chasse plusieurs attaques meurtrières contre les unités combattantes du MPLA (dont l’état-major était au Congo-Léopoldville au début de la lutte de libération, en 1961)7.
L’assassinat par le FNLA de cinq cadres du détachement féminin du MPLA (dont Deolinda Rodrigues, une écrivaine angolaise qui avait côtoyé Martin Luther King), faites prisonnières alors qu’elles traversaient la frontière congolaise pour rejoindre les zones de combat en territoire angolais, est encore dans beaucoup de mémoires en Angola. Détenues une année durant dans une prison de Kinkuzu, au Zaïre, elles furent tuées en 1968. Les attaques du FNLA contre le MPLA n’ont jamais cessé, même après l’accord pour l’unité des deux organisations, signé en juin 1972 par leurs leaders respectifs, Holden Roberto et Agostinho Neto.
Les attaques à caractère raciste, contre les Blancs et les Métis, qui ont marqué la première action armée du FNLA en territoire angolais, le 15 mars 1961, ont rendu les autorités coloniales portugaises méfiantes mais elles ont fini, après le 25 avril 1975 notamment, et sous la pression des États-Unis, par tenter de favoriser ce mouvement foncièrement anticommuniste. Cependant, en juin 1975, en plein gouvernement quadripartite (MPLA, FNLA, Unita et Portugal) de transition vers l’indépendance de l’Angola, le FNLA sort de facto de ce cadre après avoir tenté, en vain et à deux reprises, de prendre Luanda par la force.
Révoltes intestines au MPLA
L’Unita, entrée dans le processus des négociations pour l’indépendance de l’Angola en tant que force-tampon entre les deux frères ennemis et soutenue par le Portugal qui espérait mettre à profit ses relations nouées avec Savimbi, en sort de son propre gré, peu après le FNLA, se retirant à Huambo avec armes et bagages. Le haut-commissaire portugais, Silva Cardoso, mais également le consul américain encore sur place, tentent en vain de convaincre Savimbi de rester au sein du gouvernement de transition. Ils craignent que le départ de Savimbi en provoque la cessation.
Position ingénue que celle des Portugais qui ont cru pouvoir compter sur leur ancien protégé, alors que Savimbi a déjà noué des contacts avec l’Afrique du Sud, avec laquelle il partage le même but : exclure le MPLA du processus d’indépendance. La première rencontre de Savimbi avec les autorités sud-africaines a lieu en octobre 1974. Les premières aides militaires suivent peu après. Quant au MPLA, après une année 1974 extrêmement difficile, il regagne sa légitimité après le retour triomphal d’Agostinho Neto à Luanda, le 4 février 1975.
En effet, au lendemain de la révolution portugaise du 25 avril 1974, le MPLA est affaibli par l’annonce publique d’une dissidence, « Revolta Activa », qui proteste contre l’absence de démocratie interne. Constituée à Brazzaville par un groupe de cadres angolais, dont certains historiquement importants, « Revolta Activa » va en effet s’ajouter à la contestation surgie deux ans plus tôt, dans la province orientale de Moxico, au sein des combattants du MPLA : la « Revolta do Leste », dirigée par Daniel Chipenda. En dépit de plusieurs mois de débats et de tentatives de réconciliation gérées par des cadres du mouvement sur le terrain et certains des futurs promoteurs de « Revolta Activa », cette crise, qui a éclaté en fin 1972, n’a pas été résorbée. Après le 25 avril, avec le surgissement de « Revolta Activa », la direction de Neto n’est plus, aux yeux de ceux qui misaient sur son affaiblissement mortel, qu’une troisième faction.
(La suite à lire ici.)
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1António de Spínola, Le Portugal et son avenir (Portugal e o Futuro), Flammarion, 1974.
2Luís Nuno Rodrigues, Marechal Costa Gomes, No centro da tempestade, éditions A esfera dos livros, 2008.
3Benjamin Almeida, Angola, o Conflito na Frente Leste, Âncora Editora, 2011.
4Expression attribuée à un agent des renseignements français.
5Pierre-Guillaume de Roux et Yves Loiseau, La Table ronde, 1987.
6Yves Bréhèret, Édouard Sablie, Olivier d’Ormesson, Nouvelles éditions latines, 2008.
7Installé dès 1961 dans ce pays qui comptait déjà plusieurs centaines de milliers de réfugiés angolais, le MPLA y établit sa principale représentation. C’est à Kinshasa que Mário de Andrade passe la main à Agostino Neto en 1962, après l’évasion de ce dernier du Portugal. Mais l’hostilité du gouvernement, avant même Mobutu, s’accentue au point que Neto et sa famille sont contraints de fuir nuitamment à Brazzaville, aussitôt après la prise de pouvoir de Massamba-Debat (août 1963). Les structures du MPLA (combattants, médecins, secrétariat) restent d’abord sur place. Mais après de multiples attaques meurtrières contre les unités de combattants du MPLA le long de la frontière avec l’Angola, la représentation finit par fermer. En même temps, la Zambie autorise (en 1966) la création de bureaux à Lusaka et des bases à la frontière avec l’Angola, et l’essentiel de l’effort se tourne vers la région est du pays.
8António de Spínola, Le Portugal et son avenir (Portugal e o Futuro), Flammarion, 1974.
9Luís Nuno Rodrigues, Marechal Costa Gomes, No centro da tempestade, éditions A esfera dos livros, 2008.
10Benjamin Almeida, Angola, o Conflito na Frente Leste, Âncora Editora, 2011.
11Expression attribuée à un agent des renseignements français.
12Pierre-Guillaume de Roux et Yves Loiseau, La Table ronde, 1987.
13Yves Bréhèret, Édouard Sablie, Olivier d’Ormesson, Nouvelles éditions latines, 2008.
14Installé dès 1961 dans ce pays qui comptait déjà plusieurs centaines de milliers de réfugiés angolais, le MPLA y établit sa principale représentation. C’est à Kinshasa que Mário de Andrade passe la main à Agostino Neto en 1962, après l’évasion de ce dernier du Portugal. Mais l’hostilité du gouvernement, avant même Mobutu, s’accentue au point que Neto et sa famille sont contraints de fuir nuitamment à Brazzaville, aussitôt après la prise de pouvoir de Massamba-Debat (août 1963). Les structures du MPLA (combattants, médecins, secrétariat) restent d’abord sur place. Mais après de multiples attaques meurtrières contre les unités de combattants du MPLA le long de la frontière avec l’Angola, la représentation finit par fermer. En même temps, la Zambie autorise (en 1966) la création de bureaux à Lusaka et des bases à la frontière avec l’Angola, et l’essentiel de l’effort se tourne vers la région est du pays.
