
David Lurie est un professeur d’université de 52 ans, il aurait tout aussi bien pu en avoir 82, David Lurie se sent comme un vieil homme, pense comme un vieil homme, observe et subit les changements sociaux comme un vieil homme qui voit son monde et ses certitudes s’écrouler tandis que son corps se délite. Il se passionne pour les poètes romantiques et voudrait se consacrer à la recherche dans ce domaine, nécessité faisant loi, il est tenu d’enseigner à des étudiants ignares les subtilités d’un poème de Wordsworth ou les métaphores mélancoliques d’un Byron. Sa situation déjà peu gratifiante empire avec les changements imposés par la rationalisation des universités. Il était titulaire d’une chaire de lettres modernes, il se retrouve professeur en techniques de communication et « comme il n’a aucun respect pour ce qu’il doit enseigner, il laisse ses étudiants indifférents ». David Lurie s’adapte au déclassement social et intellectuel à sa manière, il résiste, apprend à se satisfaire de peu.
Le livre s’ouvre sur la vie privée du personnage : divorcé deux fois, il entretient une relation hygiénique et tout à fait satisfaisante à ses yeux avec une prostituée, Soraya. Il la voit une fois par semaine, deux heures, et cela suffit à son bonheur. « Il est en bonne santé, il a l’esprit clair. De métier il est, a été chercheur, et de temps à autre, au fond de lui-même, il sent encore un élan qui le porte à la recherche. Il vit dans les limites de ses revenus, de son tempérament, selon ses moyens, pour ses émotions et le reste. Est-il heureux ? À l’aune quelle qu’elle soit dont on mesure le bonheur, oui, il croit qu’il est heureux. »
Un feu s’allume et le consume
Mais David Lurie en veut davantage, il a beau dire, s’en convaincre, il n’a pas renoncé aux affres de la passion. Sa relation avec Soraya tourne court lorsqu’il outrepasse les limites entendues et négociées en prenant sa conscience professionnelle pour de l’affection. C’est alors qu’il croise Mélanie, une de ses étudiantes, de trente ans sa cadette. Il entame avec elle une liaison où enfin s’allume le feu qu’il recherche et qui le consumera. Mélanie n’est pas consentante, pas vraiment, pas explicitement.
Ne pars pas, passe la nuit avec moi.
– Pourquoi est-ce que je devrais faire ça ?
[…]
– Pourquoi ? Parce que la beauté d’une femme ne lui appartient pas en propre, cela fait partie de ce qu’elle apporte au monde, comme un don. Elle a le devoir de la partager.
[…]
– Et si je partage déjà ?
– Eh bien tu devrais partager plus généreusement.
David Lurie croit ce qu’il dit, dans le jeu de la séduction, quand Eros prend la main, la beauté de la femme appartient à l’homme, elle a le devoir de la lui offrir. Il mêle Shakespeare à la sauce, intellectualise ses pulsions. Mélanie lui oppose une timide résistance à laquelle son désir souverain n’accorde aucune place. Elle se laisse faire plutôt qu’elle ne participe, elle subit sa frénésie, le bouillonnement qu’elle a déclenché en lui, dont elle est un peu responsable, lui explique-t-il, et qu’il ne peut pas dompter. Son plaisir est total, irrésistible. Même lorsque la situation dérape, que le petit ami de Mélanie le menace, qu’il est obligé de se compromettre en lui attribuant une bonne note à une évaluation à laquelle elle n’a pas assisté, il ne peut se résoudre à renoncer à son petit corps, jeune, sans défaut et délicieusement soumis.
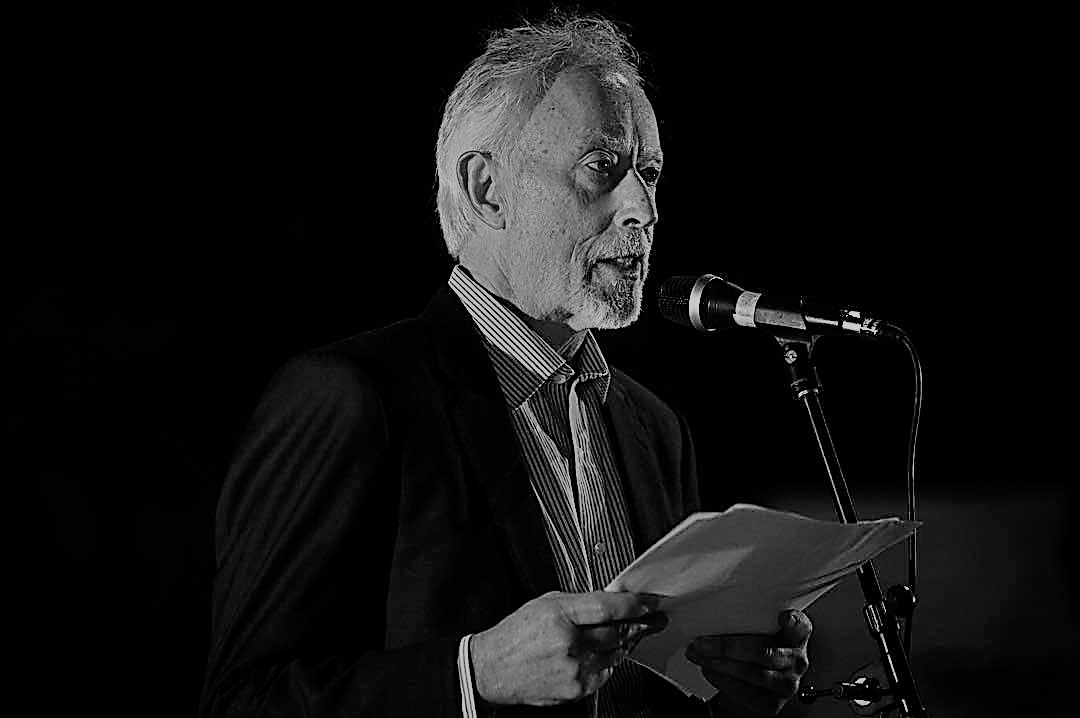
Les choses s’enveniment comme c’était à prévoir, comme il le prévoyait lui-même sans penser toutefois que son infortune surviendrait si rapidement et avec une telle ampleur « si seulement il avait su que le temps serait si court ». Mélanie et sa famille portent plainte pour harcèlement, l’université le convoque à une commission qui doit statuer sur son cas.
Le stoïcisme de qui se sait évalué par des incultes
Là, apparaît le beau, le grand David Lurie tel qu’il n’a jamais cessé d’exister dans son esprit. Il reconnaît ses torts, plaide coupable mais refuse de s’abaisser à demander pardon ou même à justifier ses actes. Il veut s’en tenir au droit, il a commis un acte répréhensible et accepte la sanction prévue, il ne se soumettra pas à l’humiliation publique, il refuse la castration que la société veut lui imposer pour avoir au fond obéi à sa nature profonde et même à ce que la nature a de plus « naturel ». Il est traîné dans la boue par les médias, ostracisé par le corps enseignant, ses alliés ne peuvent pas le soutenir puisqu’il se rebelle contre l’idée de la repentance publique pré-requise. David Lurie sera jugé par tous avant son procès et condamné par la justice. Il subit sa mise à l’index sociale avec le stoïcisme de qui se sait évalué par des incultes. Il est contraint à la démission et décide de partir du Cap quelque temps pour se réfugier chez sa fille, qui possède une ferme à l’intérieur du pays.
Le roman, pourrait-on penser, commence ici. Pourtant, ce qui précède est nécessaire pour comprendre qui est David Lurie. Un homme blanc, vieillissant dans une Afrique du Sud où Mandela et De Klerck proposent une Tabula rasa du passé pour construire une nation nouvelle. Un nouveau roman écrit dans l’encre arc-en-ciel de la résilience, du pardon et de l’amour partagé, est présenté au monde, avec ses héros et ses bâtisseurs.
La réalité est plus triviale, en lien avec le « faites la paix, pas l’amour » d’Amos Oz, la paix « n’entend pas une communion mystique mais un compromis juste et raisonnable entre contraires ». Les relations violentes et dégradantes qui lient les races en Afrique du Sud ne peuvent être abolies par de bons sentiments, il n’en demeure pas moins qu’elles sont préjudiciables et mortifères pour le corps social entier. La colère et le ressentiment, les anciennes pratiques ne disparaîtront pas mais un changement politique radical, une négociation plus équitable des espaces de liberté s’imposent.
David Lurie est un « bon Blanc » : éduqué, cultivé, il aime la poésie, l’opéra, il a voyagé et est plutôt ouvert. Il serait assez d’accord, non pas pour aimer qui on lui indique – ses amours sont ses affaires, si une chose est claire c’est celle-là – mais on devine qu’il souscrirait volontiers à l’idée d’une paix négociée, tenant compte des intérêts bien compris des uns et des autres. Reste que la société nouvelle le brusque, le déconcerte. Il en connaît les codes mais répugne à les faire siens, au fond de lui, n’en admet pas le bien-fondé. Il n’essaie pas d’imposer ses convictions – bien maigres au demeurant –, mais il sait, intimement, qu’il est dans le vrai. Il l’a toujours été sans avoir à confronter plus que nécessaire sa place dans le monde aux exigences d’autres personnes. Lorsqu’il se heurte violemment à ces autres légitimités, il se braque, considérant qu’il s’agit de la limite non négociable de sa liberté, la sphère inviolable où aucune intrusion ne saurait être tolérée.
David Lurie prend trop de place et ne cède pas d’un pouce, en tout cas ne cède rien de ce qu’il devrait pour un partage plus équitable de l’espace politique et philosophique né de la fin de l’apartheid. Il croit encore pouvoir faire face, conserver un semblant de quant à soi : il se trompe.
La question raciale ne peut être ni poétisée ni sous-entendue
Jusqu’ici, les personnages ne sont pas décrits par leur couleur de peau. David Lurie, à un moment du récit, transforme le « Mélanie » en « mélanine », sous-entendant une réalité qui ne sera pas approfondie. Dans le film tiré du livre, réalisé par Steve Jacobs en 20081, Soraya la prostituée et Mélanie sont jouées par deux actrices métisses : Nathalie Becker et Antoinette Engel. David Lurie a été deux fois marié à des femmes blanches et a eu avec d’autres Blanches des liaisons épisodiques et sans histoires. Sa chute viendra de ces deux femmes avec lesquelles il entretient une relation de domination, elles sont racisées, jeunes, fragiles, l’une se fait payer ses services tout en essayant de dissimuler son statut d’épouse et de mère, l’autre est son étudiante, une jeune femme un peu paumée qui cherche sa voie. Et s’il est loin d’être une brute, il se sert très largement de ce qu’il est, du pouvoir qu’il représente pour les posséder bien au-delà de ce qu’elles sont disposées à lui offrir.
La question raciale que l’on devine centrale et que jusqu’ici l’auteur distille par petites touches n’apparaît clairement qu’à son voyage à Salem, la petite ville à l’intérieur du pays où vit sa fille, et avec l’entrée en scène de Pétrus. À Salem, dans l’Afrique du Sud profonde, la question raciale ne peut ni être poétisée – Mélanie, mélanine – ni être sous-entendue ou métaphorisée. Elle est une réalité palpable et incontournable du quotidien.
Lucy, la fille de David Lurie, est lesbienne, elle vient de rompre avec sa compagne et vit seule dans une ferme où elle cultive des fleurs, des légumes qu’elle vend au marché, et possède un chenil : les gens lui confient des chiens dont elle s’occupe pendant leur absence. Elle a d’abord embauché Pétrus comme homme à tout faire avant qu’il bénéficie d’une subvention lui permettant d’acheter de la terre à Lucy et d’y installer sa famille.
David Lurie ne comprend pas les choix de sa fille, il juge durement son physique, son absence de coquetterie, la proximité de Pétrus ne le réjouit pas, les voisins non plus n’obtiennent pas grâce à ses yeux. Mais, rappelons-le, notre homme est un « bon Blanc » plutôt citadin et cosmopolite, avec un faible pour les femmes jeunes et apprêtées, habitué à fréquenter des personnes cultivées. Il n’approuve pas les choix de sa fille mais fait preuve d’une bienveillante condescendance. Elle mérite mieux, possède les moyens de ce mieux, mais il est un homme, un père moderne et aimant capable d’accepter le choix de son enfant à défaut de les approuver.
Réduit à la plus abjecte des impuissances
Leur vie bascule le jour où ils sont agressés dans la maison par trois individus. L’auteur n’a pas besoin de préciser qu’ils sont noirs :
Trois hommes s’avancent vers eux sur le chemin, ou plutôt deux hommes et un jeune garçon. Ils marchent vite, à grandes enjambées, comme des paysans. Le chien que Lucy tient en laisse ralentit, hérisse le poil :
– Il y a lieu de s’inquiéter ? dit-il à voix basse.
– Je ne sais pas.
Elle raccourcit les laisses des dobermans. Les hommes arrivent à leur hauteur. Signe de tête, salut, ils se sont croisés.
Les mots, la construction des phrases disent la menace que représentent ces personnes avant même le forfait accompli. Ils enferment David Lurie dans les toilettes pendant qu’ils abusent de sa fille avant de dérober ses biens, de tuer les chiens, de l’asperger lui d’essence, d’y mettre le feu et de s’enfuir avec la voiture. Tout est contenu dans cette scène. Ce dont il sent confusément la menace depuis le départ et contre quoi il essaie de se défendre sans oser le nommer : « Nous y voilà, le jour J. Sans crier gare, sans tambour ni trompette, on y est, et il est en plein dedans. » Des Noirs pénètrent dans son intimité par la force, le cantonnent comme un étron dans les WC, souillent sa fille de leur semence, essaient de le réduire en cendres, tuent les chiens censés assurer sa protection et volent ses biens. Il est réduit à la plus totale, la plus abjecte des impuissances. Lui qui redoutait d’être castré par la part civilisée de cette société qu’il ne comprend plus et qu’il n’essaie même pas de comprendre est submergé, disloqué par son versant sauvage et barbare. Il s’impose à lui, le viole lui aussi, le soumet avec brutalité. Il le dépouille de tout ce qui fait de lui un être intact, complet. Il le brise.
Il y a peu de métaphore dans ce livre, le style est direct jusqu’à la sécheresse, il n’y a aucun trait d’humour, pas de respiration poétique. Coetzee nous plonge dans le corps de David Lurie, dans son esprit, son ventre. Nous savons tout des obsessions sexuelles qui jamais ne le quittent tout à fait – lorsqu’il décide de rendre visite à la famille de Mélanie pour lui présenter des excuses, il fait la connaissance de la jeune sœur, beauté prépubère. Alors même qu’il fait acte de contrition, notre homme ne peut s’empêcher de fantasmer sur le fait d’avoir les deux sœurs dans son lit – « des ébats dignes d’un roi » –, sur son sentiment de supériorité, de complaisance vis-à-vis de lui-même. Cette incursion ne se fait pas dans un « je » de solidarité et de connivence, mais avec le recul de la troisième personne. Nous assistons à toutes les étapes intimes de la déchéance de David Lurie en étranger, en spectateur non autorisé, en voyeur.
Les événements d’hier lui ont donné un choc qui l’ébranle au plus profond de lui-même. Les tremblements, la faiblesse ne sont que les conséquences superficielles de ce choc. Il a le sentiment qu’à l’intérieur un organe vital a été meurtri, brutalisé – ce pourrait même être son cœur.
Lucy se détourne de son père. Il voudrait qu’elle porte plainte pour viol, elle se contente de signaler l’agression et les vols. Il tient Pétrus, opportunément absent pendant les événements, pour responsable, au moins complice. Elle refuse de l’incriminer même lorsqu’elle reconnaît un de ses agresseurs, beau-frère de Pétrus – alors qu’ils sont invités à une fête chez ce dernier. Elle s’isole, s’enferme, se laisse aller et refuse toute aide de son père. Il voudrait qu’elle quitte sa ferme où personne, pas même lui, ne peut lui assurer un minimum de sécurité. Pour David Lurie, la question est économique, Pétrus veut la ferme de Lucy, il a organisé cette attaque pour lui faire peur. Il faudrait porter plainte, désigner les coupables, se mettre sous la protection de la loi pour obtenir justice, réparation. Pour Lucy, cela signifierait déplaire à Pétrus et mettrait un terme à tout espoir de conserver sa ferme, sa vie ici, or, elle ne veut pas partir. Malgré les exhortations, menaces, suppliques de son père, elle refuse de se laisser chasser.
À l’implacable barbarie, elle oppose son indomptable vulnérabilité
Le désir de ces hommes était inspiré par la haine et le mépris. Plus que de la posséder ils voulaient l’avilir, l’humilier. Lucy parle d’une vieille créance, une dette ancienne que les personnes comme elles doivent payer aux personnes comme eux, un impôt prélevé par la force en remboursement de l’usurpation par ses ancêtres d’une terre qui ne leur appartenait pas et des exactions qui en ont découlé. Sa place à elle en tant que propriétaire de cette terre est aujourd’hui sujette à caution. Ici, à Salem, le rapport de force est disproportionné, une réparation à la mesure du crime commis est inenvisageable. Ils ne lui laissent pas d’autre choix que la fuite ou la réplique légale. Elle invente une troisième voie improbable et folle, elle négocie la paix.
À l’implacable barbarie, elle oppose son indomptable vulnérabilité. Elle ne se prononce pas sur le remboursement d’une obligation séculaire, puisque personne ne lui demande son avis, ni les agresseurs assurés de leur bon droit, ni les injonctions patriarcales. Elle envisage les solutions qui s’offrent à elle si elle veut préserver son intégrité physique, soustraire son esprit à la folie, et choisit de céder une part de sa liberté, de sa dignité, pour conserver le droit d’habiter sa terre.
Un enfant est conçu de ces outrages. Lucy décide de le garder et d’accepter la proposition en mariage de Pétrus. Il ne s’agit pas d’un mariage sentimental, mais d’une alliance de raison comme cela s’est fait longtemps et partout. L’homme leur assure refuge et protection à elle et à son enfant à naître, elle lui cède ses terres. Elle n’aime pas les hommes, il ne la désire pas. Peut-être une fois fera-t-il valoir ses droits, comme on tope pour valider un accord, mais pas davantage. Il ne s’agit pas de cela. Nous sommes dans une société primitive où seuls comptent les liens de sang et d’héritage. Pétrus et Lucy se comprennent à demi-mot. David Lurie ne peut se résoudre à accepter ce monde qu’il méprise profondément et qui le blesse, mais il n’a nulle part où aller. Son sang ainsi mêlé à celui de l’Autre lui fait deviner une disparition à échéance de tout ce qu’il est, tout ce en quoi il croit. Il voit venir avec effroi le Grand Remplacement honni.
Celui qui souffre doublement et meurt en silence
Disgrâce a été lu par beaucoup comme une critique acerbe du mythe d’une Afrique du Sud postapartheid heureuse dans sa pluriracialité, sa pluriculturalité, ou comme un tableau de l’inquiétude de la société occidentale face à ce que je nommerais les nouvelles légitimités. David Lurie est narcissique jusqu’à l’absurde, et sa vision des autres est un fatras de préjugés :
Les femmes racisées, irrésistiblement sensuelles et rien d’autre : « Il a toujours été attiré par des femmes d’esprit. Il recherche l’esprit et la beauté. Avec la meilleure volonté du monde, il n’a pas trouvé une once d’esprit chez Mélanie, accent tonique sur la deuxième syllabe. Mais de la beauté à revendre. »
Les lesbiennes : « L’amour saphique est une excuse pour prendre du poids. »
Les Noirs : violeurs de métier, fornicateurs invétérés – Pétrus est polygame, Lucy sera sa troisième épouse –, calculateurs, mortellement dangereux, irrémédiablement étrangers.
Les jeunes, les femmes célibataires, les croyants… Nul ne trouve grâce à ses yeux.
Mais pour comprendre pleinement ce personnage, il convient d’explorer son rapport aux chiens de Bev Adams. David Lurie s’engage comme bénévole auprès de Bev Adams, une voisine de Lucy propriétaire d’une sorte d’enclos dans lequel elle procède à des euthanasies sur les animaux, en particulier sur des chiens. Lucy garde des chiens de race choyés dans des foyers de Blancs, alors que ceux qui atterrissent chez Bev pour y finir leurs jours sont maltraités, malades, en fin de parcours et plutôt issus de la population noire. Dans les deux cas, la violence meurtrière des Noirs s’étend jusqu’à eux, signant pour notre homme l’impossibilité d’une rencontre.
David Lurie s’attache à ces animaux, il aide à leur mise à mort avec douceur, compassion, et tient à conduire lui-même leur dépouille à l’incinérateur. Il lui arrive de pleurer de pitié pour ses pauvres bêtes. Plus sa vie lui échappe, plus il s’investit dans une mise à mort digne pour les chiens. Ces animaux en souffrance qui subissent la folie ambiante habitent l’œuvre avec une force insoupçonnée : comme un hommage aux forces obscures de la vie, celles que nous portons en nous, le soi animal et secret, à la fois sauvage et sans défense que nul n’a envie d’exposer aux yeux des autres. Celui qui souffre doublement et meurt en silence quand le monde se désagrège.
Une déflagration dans un univers confortable
L’affliction de David Lurie ne peut être minorée, sa détresse est réelle, abyssale. La lecture qu’il fait de ce qui leur arrive et des choix de sa fille est lucide, clairvoyante et désespérée. Lucy rejette sa filiation pour se choisir un allié plus puissant à ses yeux. Son père sait qu’en la circonstance les rapports de force sont fluctuants et les alliances éphémères, la seule certitude étant la vulnérabilité de sa fille et son impuissance à la protéger. Ne pouvant déterminer ce qui chez soi attise la convoitise des prédateurs et si cela correspond à ce que l’on est prêt à céder sans lutter, aucune négociation n’est envisageable. Il n’y aura pas de retour à l’innocence perdue, fantasmée. Même les chiens autrefois dressés pour grogner à la vue d’un Noir ne sont pas innocents. Aucune repentance n’atténuera la cruauté de leur sort, il préconise la fuite, elle s’y refuse, les menant dans une voie sans issue car, bien qu’elle l’en conjure, il ne se résout pas à l’abandonner.
La nation arc-en-ciel a mangé son pain blanc quand des jeunes de toutes les couleurs ont dansé dans les rues après la prise de pouvoir de Nelson Mandela. Ensuite, dans l’espoir dissous des lendemains qui déchantent, la lutte à mort pour le territoire et l’assujettissement des corps sans défense ont repris droit de cité, aggravés par les frontières rendues poreuses entre les dominants et les dominés.
David Lurie n’est pas un de ces Afrikaners habité par une haine viscérale des Noirs, malgré tout, il a jusqu’ici fait partie de la classe des seigneurs, de ceux dont on attend aujourd’hui qu’ils abandonnent une part de leurs privilèges. Cette nouvelle configuration agit comme une déflagration dans son univers confortable car il sait maintenant que la cession des privilèges donnera lieu à une lutte féroce à laquelle il n’est pas préparé. Dans ses cauchemars, il essaie d’échapper « à un homme au visage de faucon, comme un masque du Bénin, comme Thot » : le Noir comme un dieu vengeur et cruel, la proie transformée en chasseur, bien décidé à obtenir sa livre de chair fraîche.
Pour citer [la philosophe] Elsa Dorlin : « Le dispositif de pouvoir qui discrimine ceux/celles qui sont chassées ne vise pas à imposer une chasse de toutes contre toutes, mais la réduction de toutes à des proies, diluant et invisibilisant les rapports de domination dans un monde devenu invivable pour toutes mais où seules certaines sont tuables et demeurent effectivement traquées. » Et David Lurie bascule dans l’univers des proies potentielles.
La peur secrète du dominant
Son personnage est comme John Maxwell Coetzee, professeur en littérature né au Cap. Il incarne une figure familière de l’auteur. Ils sont contemporains, héritier involontaire pour Lurie et acteur pour Coetzee de la fin d’un monde (l’apartheid) et du début d’une ère qui recompose le paysage social sans parvenir à endiguer la violence congénitale de la société sud-africaine. La fin de la contention politique qui tenait les Noirs sous la coupe des Blancs dessine l’explosion d’une soupape car, aux côtés des nouvelles libertés, les plaies sud-africaines tirent leurs sources d’une constellation de conflits raciaux et ethniques dont l’apartheid a été la forme la plus achevée. La fin de ce régime n’en viendra pas à bout.
Coetzee ne peut pas ignorer que la difficile mixité génère une violence qui aujourd’hui encore s’exerce en priorité sur des Noirs et est trop souvent le fait de Noirs entre eux. Il y a bien plus de femmes noires qui se font violer et humilier en Afrique du Sud que de Lucy Lurie et peu de chances pour que la cupidité d’un Pétrus se développe au détriment d’un David Lurie.
La question est : pourquoi l’auteur inverse-t-il le paradigme ? Que nous dit la disgrâce de son personnage si ce n’est la peur secrète, inexprimée du dominant, celle qui rend toute négociation impossible. Une phrase de Mahmoud Darwich me revient en mémoire : « Non, aucune victime n’interroge son bourreau : suis-je toi, et si mon glaive avait été plus grand que ma rose… Aurais-je agi comme toi ? » Il y a chez Coetzee une tranquille impertinence, une absolue liberté de pensée : son œuvre en est irradiée. Le lecteur se dit : « Qui d’autre que lui aurait pu écrire une chose pareille ? » Et tout de suite après : il n’existait aucun moyen de le dire autrement.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
