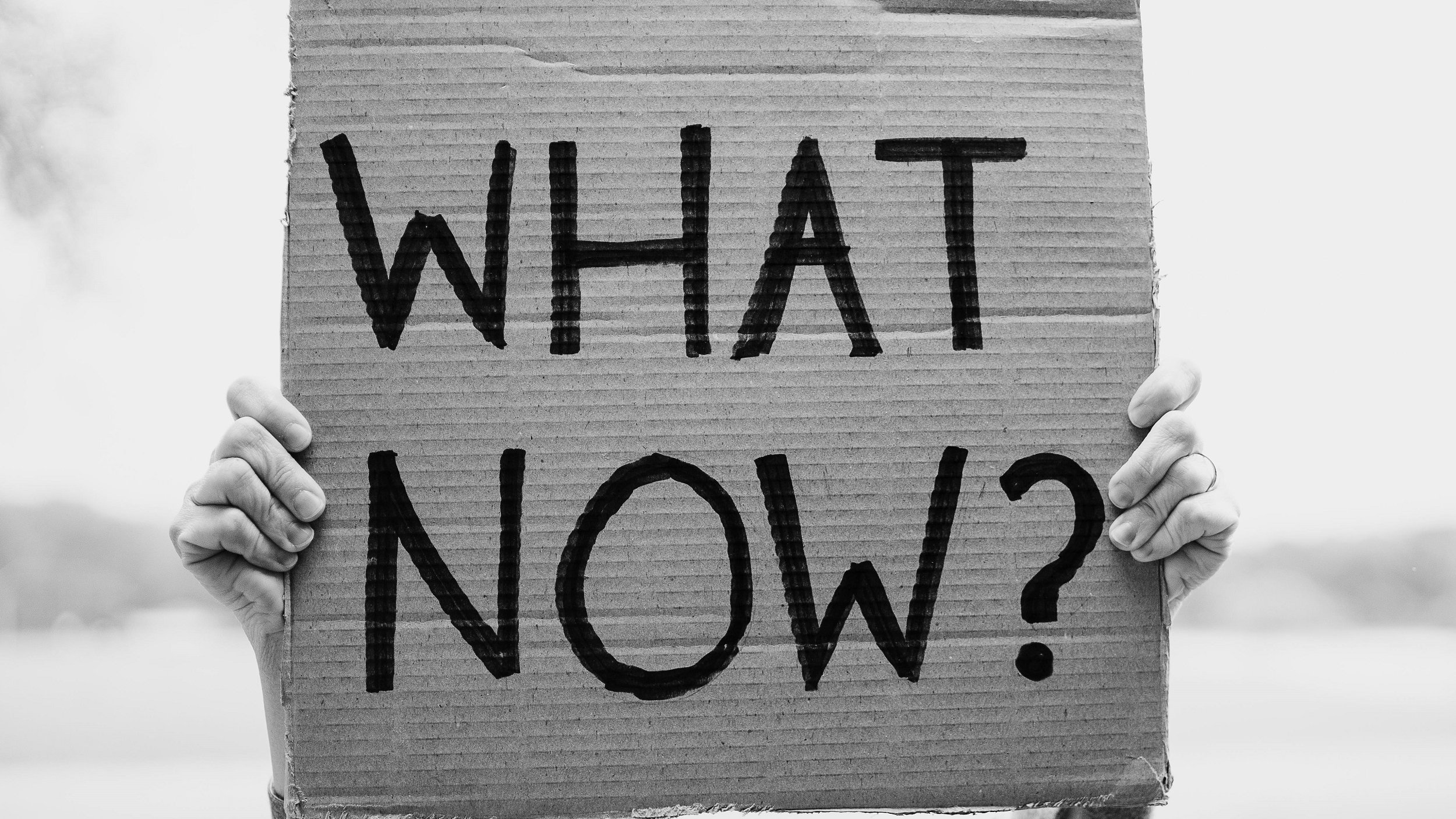
DANS L’ACTU
RWANDA-FRANCE 1994. UN NÉGATIONNISTE CONDAMNÉ, L’ARMÉE FRANÇAISE ÉPARGNÉE
Deux verdicts relatifs au génocide des Tutsies du Rwanda en 1994 ont été rendus cette semaine à Paris. Le premier condamne l’auteur franco-camerounais Charles Onana pour « complicité de contestation publique de l’existence d’un crime contre l’humanité ». Le second confirme le non-lieu délivré en octobre 2023 dans le cadre d’une plainte pour complicité par inaction contre des militaires français de l’opération militaro-humanitaire Turquoise, déployée au Rwanda entre juin et août 1994.
Le 9 décembre, Charles Onana a donc écopé d’une amende de 8 400 euros. Son éditeur, Damien Serieyx, des Éditions du toucan, doit s’acquitter d’un chèque de 5 000 euros. Les deux accusés, qui ont fait appel, doivent par ailleurs verser 11 000 euros aux parties civiles, l’association Survie, la Ligue des droits de l’homme (LDH) et la Fédération internationale des droits humains (FIDH), à l’origine de la plainte déposée en 2020.
Plusieurs passages du livre Rwanda, la vérité sur l’opération Turquoise. Quand les archives parlent (paru en 2019) étaient visés : selon Charles Onana, « le conflit et les massacres du Rwanda n’ont rien à voir avec le génocide des Juifs ! » et « la thèse conspirationniste d’un régime hutu ayant planifié un “génocide” au Rwanda constitue l’une des plus grandes escroqueries du XXe siècle ». Lors du procès, la procureure avait déclaré que l’essayiste avait « clairement dépassé les limites de la liberté d’expression » en « minorant » et en « banalisant » l’existence du génocide contre les Tutsis. En France, Onana est régulièrement cité par des militaires et des politiques français, parmi lesquels Hubert Védrine, secrétaire général de l’Élysée pendant le génocide, ainsi que le raconte Afrique XXI.
Deux jours après cette condamnation, le 11 décembre, la justice française a en revanche décidé qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour poursuivre les cinq militaires de l’opération Turquoise accusés d’inaction entre le 27 et le 30 juin 1994 à Bisesero.
En juin 1994, des milliers de Tutsies se réfugient sur cette chaîne de collines du nord du Rwanda et subissent les attaques de militaires et de miliciens hutus. Le génocide, qui fera près de 1 million de victimes entre avril et juillet 1994, bat son plein. À quelques kilomètres de là se trouve une base de l’opération Turquoise déployée dans le pays le 22 juin. Dès le 27 juin, des militaires qui se sont rendus à Bisesero et qui ont promis aux réfugiées de revenir au plus vite préviennent leur hiérarchie de ce qu’ils ont vu et l’informent de la menace qui pèse sur ces déplacées. Mais les Français n’interviendront que trois jours plus tard, condamnant à mort des centaines de Tutsies.
Les parties civiles – des rescapées, l’association Survie, la FIDH, la LDH et Ibuka, qui défend les victimes du génocide – n’excluent pas de porter l’affaire devant la Cour de cassation. Pour Survie, cette nouvelle décision est « un déni de justice pour les rescapées et les familles des victimes ». Pour Patrick Baudouin, l’avocat de la FIDH, « ce n’est pas une surprise [au vu des] résistances pour mettre en jeu la responsabilité des militaires et à plus forte raison des autorités publiques françaises ». Il y a quelques semaines, le Tribunal administratif s’était d’ailleurs déclaré incompétent pour juger les actions ou inactions des autorités françaises pendant le génocide des Tutsies...
Comme un symbole des ambiguïtés françaises, le général Jean-Claude Lafourcade, qui fut le chef de l’opération Turquoise, est apparu dans les deux dossiers : accusé dans l’affaire Bisesero, il a été cité comme témoin par la défense de Charles Onana.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
À VOIR
TIGRAY. LE VIOL, PLAIE BÉANTE DE LA GUERRE
« Voilà comment nous faisons les choses. Nous continuerons jusqu’à être sûrs que les femmes tigréennes ne donnent plus jamais naissance » : ce message, qui avait été écrit sur un bout de papier et enveloppé dans du plastique, a été retiré du vagin d’une jeune femme deux ans après qu’il y fut introduit par la force. Clous, coupe-ongles, vis, lames de rasoir ont aussi été utilisés pour torturer sexuellement des milliers de Tigréennes durant l’effroyable guerre civile éthiopienne qui a duré de novembre 2020 à novembre 2022.
Ces atrocités sont décrites dans un documentaire choc de 37 minutes, Viol, l’arme du silence, réalisé par Marianne Getti et Agnès Nabat et disponible sur la chaîne franco-allemande Arte. Combien de femmes ont été violées durant ce conflit à huis clos ? Peut-être 120 000, soit 1 Tigréenne sur 10, selon une étude menée par l’Hôpital central de Mekelle, la principale ville du Tigray (nord de l’Éthiopie). Mais ce chiffre pourrait être « la partie émergée de l’iceberg », témoigne une infirmière qui soigne les victimes. « Comment des êtres humains peuvent-ils faire ça à d’autres êtres humains ?, s’interroge-t-elle, n’ont-ils pas de sœur, de mère ? »
Le film s’intéresse particulièrement au combat de Meseret, une célèbre pianiste tigréenne. Il y a un an, elle crée son organisation pour venir en aide aux femmes victimes de viol. Et elle est très vite dépassée : elle a déjà traité 4 200 demandes alors qu’elle pensait n’en traiter « que » 1 000…
Le viol, dont l’utilisation comme arme de guerre a atteint une ampleur terrifiante au Tigray, reste un tabou dans le pays. Les victimes, meurtries dans leur chair et traumatisées, sont marginalisées et traitées de « rebus de l’ennemi ». Elles se retrouvent seules et démunies, parfois avec un enfant issu de leur agression. Le régime éthiopien cherche à mettre le problème sous le tapis. Meseret a déjà été arrêtée et emprisonnée : parler de cela mettrait en danger « la paix », lui ont asséné les autorités. Le gouvernement tigréen n’a pas non plus intérêt à ce que ces monstruosités soient étalées au grand jour : ses troupes ont elles aussi utilisé le viol en représailles, dans les régions voisines de l’Amhara et de l’Afar.
À voir : Tigré : viols, l’arme silencieuse, de Marianne Getti et Agnès Nabat, 2024, 36 min.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SONDAGE
QUE PENSEZ-VOUS D’AFRIQUE XXI ?
Qui êtes-vous ? Qu’attendez-vous des médias en règle générale, et d’Afrique XXI en particulier ? Que souhaitez-vous voir évoluer dans votre journal en ligne ? Trois ans après la création d’Afrique XXI, nous lançons une première enquête auprès de nos lectrices et lecteurs pour mieux vous connaître, mais aussi pour comprendre vos attentes.
Afrique XXI est un journal totalement indépendant, sans publicité, et dont l’ensemble des articles et podcasts est en accès libre. Nos principaux soutiens financiers, c’est vous, par le biais des abonnements volontaires et des campagnes d’appel aux dons. Il est donc important non seulement de connaître vos attentes, mais aussi de vous permettre de nous donner vos avis et vos idées sur ce que nous pourrions améliorer.
Merci d’avance pour le temps que vous accorderez à ce questionnaire anonyme. Cela ne vous prendra que quelques minutes, mais cela nous aidera beaucoup. Nous vous tiendrons informées des résultats de cette enquête.
POUR RÉPONDRE ANONYMEMENT AU QUESTIONNAIRE, C’EST ICI !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LES ARTICLES DE LA SEMAINE
« La vie nous gêne. » Au Cameroun, la survie avant la politique
Reportage Pendant des semaines entre septembre et octobre, des rumeurs ont annoncé la mort du président camerounais, Paul Biya, âgé de 91 ans. Une fausse nouvelle qui n’a pas perturbé les Camerounais, dont le quotidien est mis à mal par une succession de crises, économiques et sécuritaires.
Par Marie-Emmanuelle Pommerolle
À la prison de Makala de Kinshasa, les failles de la vie nocturne
Analyse La spectaculaire flambée de violence du 2 septembre, à la prison centrale de Makala, dans la capitale de la RD Congo, où des centaines de femmes ont été violées, a été traitée par les autorités comme une tentative d’évasion. Ces dernières évacuent un peu vite les problèmes structurels, comme la surpopulation et les défauts de surveillance la nuit, faute d’investissements.
Par Denis Augustin Samnick
Au Burkina Faso, les journalistes face à leurs vieux démons
Enquête Le 13 décembre 1998, le journaliste d’investigation Norbert Zongo perdait la vie dans l’incendie de sa voiture. Vingt-six ans après ce crime impuni, les journalistes burkinabè sont à nouveau ciblés par le pouvoir politique. Les suspensions et les enlèvements se multiplient, et, petit à petit, l’autocensure s’impose.
Par Malik Kassongué
In English
Kinshasa’s Makala prison : incompetence brings women’s night terror
Analysis The spectacular outbreak of violence on September 2, 2024 at the Makala central prison in the capital of Democratic Republic of the Congo, where hundreds of women were raped, has been treated by the authorities as an escape attempt. The authorities are quick to dismiss structural problems, such as overcrowding and poor night-time surveillance due to lack of investment.
By Denis Augustin Samnick
Vous aimez notre travail ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
