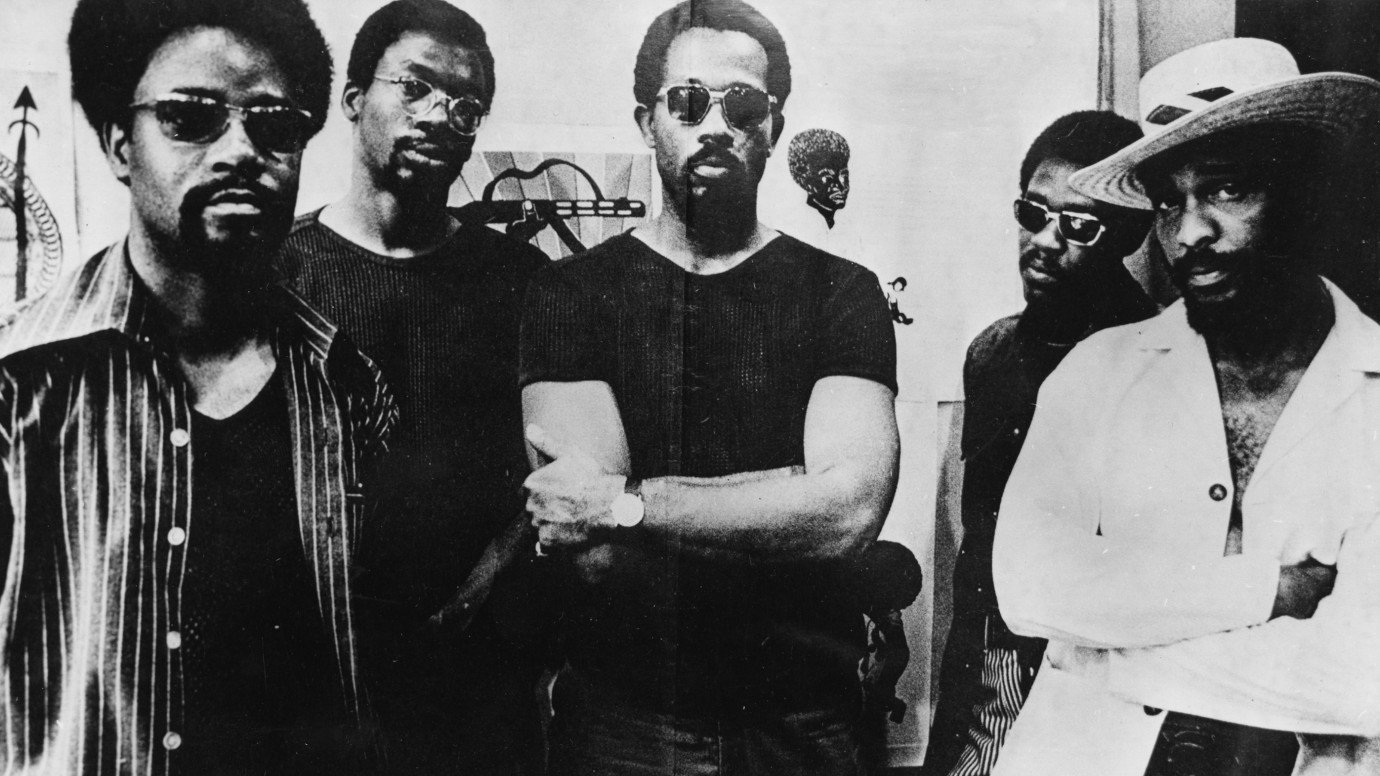
Le début de l’année 1971 est une période difficile pour Eldridge Cleaver, membre éminent du Black Panther Party. En exil depuis 1968 à la suite d’une fusillade avec la police d’Oakland, il vivait à Alger et tentait, avec sa femme Kathleen, de maintenir la « section internationale » des Black Panthers. Mais les conflits de stratégie au sein du parti, alimentés par l’infiltration et la violence du FBI, atteignent un point de rupture en février, lorsque le cofondateur du parti, Huey Newton, écarte Eldridge Cleaver et le reste du groupe d’Alger. Pire encore, les États « marxistes-léninistes » que Cleaver avait le plus admirés – la Chine et la Corée du Nord – amorcent un processus d’assouplissement de leurs relations avec le principal adversaire des Panthers : le gouvernement américain.
Se sentant délaissés et isolés, les époux Cleaver acceptent une invitation à se rendre à Brazzaville, capitale de la République populaire du Congo récemment proclamée. Après avoir essayé de construire aux États-Unis un mouvement qui fusionnait la libération des Noirs et la révolution socialiste, les Cleaver ont été convaincus par le premier gouvernement marxiste-léniniste autoproclamé d’Afrique. À la fin du voyage, revenant plein d’enthousiasme pour ce qu’il a vu au Congo, Eldridge écrit :
Ce que l’Union soviétique signifiait pour l’Europe, ce que la Chine signifiait pour l’Asie et ce que Cuba signifiait pour l’Amérique latine, la République populaire du Congo le signifie pour l’Afrique et pour les Noirs du monde entier... Maintenant, pour la première fois dans l’histoire, l’Afrique et le monde noir disposent d’un tel centre de pouvoir populaire. Et ce pôle est appelé à exercer sur l’Afrique et les Noirs le même type d’influence que les autres pôles ont exercé dans leurs régions du monde et sur leurs peuples.
Mais le voyage à Brazzaville est aussi l’occasion d’expérimenter un nouveau moyen de communication à l’époque : la vidéo. Les Cleaver, rejoints par deux autres militants des Panthers, ont apporté à Brazzaville une caméra vidéo portative, confiée au photographe Bill Stephens. Stephens a rapidement monté les images (avec les conseils du cinéaste français Chris Marker au téléphone), qu’Eldridge a ensuite commentées. Comme l’explique l’historien Sean L. Malloy 1, le film qui en résulte, Congo Oyé (We Have Come Back), est à l’origine du Revolutionary People’s Communications Network. Le réseau, dirigé par Kathleen Cleaver, a tenté de créer, de reproduire et de distribuer rapidement des vidéos qui relieraient des groupes disparates d’anciens Panthers et leurs partisans dans le monde entier. Mais Congo Oyé a rapidement été oublié avant qu’une copie soit retrouvée il y a une dizaine d’années : elle était conservée à la bibliothèque publique de New York.
Au cœur d’une révolution méconnue
Grossièrement découpé et d’une durée d’un peu plus de 46 minutes, ce film est d’une simplicité trompeuse. La narration d’Eldridge Cleaver transforme les images en une leçon pour les Noirs américains sur le pouvoir de la souveraineté noire et de la lutte armée. Mais dans les intervalles, entre les récits de Cleaver, le film offre aussi un aperçu rare d’une révolution africaine peu connue et de la pensée de ses dirigeants les plus engagés, dont certains seront exécutés à peine deux ans plus tard. Ce que le film montre de manière si convaincante, c’est comment ces militants – certain américains et d’autres congolais – sont arrivés à des interprétations différentes de la révolution.
Les ex-Panthers ont atterri à Brazzaville plus de sept ans après le début de la révolution congolaise. Pourtant, pour eux, tout était nouveau. Contrairement à la narration pleine d’assurance d’Eldridge Cleaver dans le documentaire, la caméra les filme principalement en train d’écouter leurs homologues congolais, Kathleen prenant de nombreuses notes et traduisant. Le film laisse entendre qu’ils étaient là comme des étudiants appliqués d’une révolution qu’ils découvraient à peine.
Depuis le début des années 1960, les activistes noirs américains ont suivi de près les événements au Congo, mais pas ce Congo-là. À l’époque, c’est l’autre Congo, dont la capitale, Kinshasa, est située juste de l’autre côté du fleuve éponyme, qui est connu dans le monde entier. La République démocratique du Congo (RDC) a été le théâtre de l’une des manifestations les plus flagrantes de l’ingérence néocoloniale des États-Unis et de leurs alliés de la guerre froide en Afrique. Les autorités belges et américaines ont activement travaillé à la déstabilisation du gouvernement nouvellement indépendant et ont facilité l’assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba en 1961 – plongeant le pays dans la crise et ouvrant la voie à la prise de pouvoir de l’officier militaire Joseph Mobutu, soutenu par Washington.
Le meurtre de Lumumba a radicalisé une génération de jeunes militants africains et afro-américains au début des années 1960, qui, comme Malcolm X, ont commencé à parler du Congo comme d’un symbole de l’extension de la suprématie blanche américaine à travers le monde. Or cette attention internationale a contribué à invisibiliser la révolution qui se déroulait de l’autre côté du fleuve.
La jeunesse en fer de lance
Contrairement à Lumumba, le premier président du Congo-Brazzaville, Fulbert Youlou, n’avait guère envie d’affronter le pouvoir bien établi de l’ancienne puissance coloniale, la France. Youlou était un anticommuniste convaincu, profondément hostile à Lumumba, mais aussi aux jeunes intellectuels radicaux, aux étudiants et aux dirigeants syndicaux. Mais en août 1963, les trois fédérations syndicales du Congo s’unissent pour appeler à une grève générale qui se transforme rapidement en soulèvement populaire et renverse le gouvernement de Youlou. Cette insurrection, connue sous le nom des Trois Glorieuses, restera dans l’Histoire comme premier soulèvement populaire en Afrique ayant fait tomber un gouvernement postcolonial.
Les cinq années suivantes de la révolution ont été chaotiques. Dans le vide politique créé par le soulèvement de 1963, un groupe de jeunes étudiants et de jeunes diplômés de l’université de Brazzaville se réunit pour lancer une série d’initiatives « de la jeunesse » dans le but de défendre la révolution. Par le biais de rassemblements de masse, de débats, de groupes d’étude et d’un journal, ils initient des milliers de jeunes Congolais aux concepts marxistes et anticoloniaux. Tout en mobilisant les jeunes citadins pour réparer les rues et les canalisations, les nouveaux leaders de la jeunesse ont en outre recruté des conseillers cubains pour les aider à organiser leurs partisans en milices urbaines armées. Jaloux de leur autonomie, ces leaders prennent soin de se maintenir à distance du nouveau gouvernement et de l’armée.

Au fil du temps, ils deviennent de plus en plus influents dans la politique de l’État. Les leaders congolais que les époux Cleaver ont interviewés dans Congo Oyé – Jean Baptiste Ikoko, Ange Diawara et Claude-Ernest Ndalla – sont, en 1971, des « vétérans » qui ont bâti leur influence grâce à leur travail antérieur dans des organisations de jeunesse indépendantes. Au milieu des années 1960, à de multiples reprises, de jeunes militants ont repoussé des tentatives de renversement du nouveau gouvernement venues des deux côtés du fleuve Congo.
Che Guevara à Brazzaville
Beaucoup plus cohérents dans leurs objectifs politiques que les « anciens » qui dirigeaient le nouveau gouvernement congolais, ces jeunes leaders ont pu faire passer des réformes visant à atteindre ce qu’ils appelaient la « véritable indépendance » : expulsion des troupes françaises du Congo, nationalisation du système éducatif (alors dirigé par des administrateurs et par des missionnaires étrangers) et des sociétés de services publics appartenant à des Français... Dans le même temps, des militants comme Ndalla ont contribué à faire de Brazzaville un centre pour les exilés de gauche de toute l’Afrique centrale. Les militants anticolonialistes angolais du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) sont arrivés en 1964, et, la même année, Che Guevara vient à Brazzaville pour les rencontrer – événement qui marque le début d’une campagne cubaine de trente ans de soutien au MPLA et à l’indépendance de l’Angola. Pendant la visite des Cleaver, les autorités congolaises ont d’ailleurs facilité leur voyage vers les camps d’entraînement du MPLA le long de la frontière.
Mais le contrôle sur la direction de la révolution devient de plus en plus difficile en 1968, lorsqu’un groupe de jeunes officiers de l’armée, dirigé par un capitaine de 29 ans, Marien Ngouabi, prend le pouvoir. Certains des leaders de la jeunesse acceptent de le suivre et intègrent les milices de jeunes dans l’armée nationale. Ainsi, les interlocuteurs des Cleaver dans le film, Ikoko, Diawara et Ndalla, ont fini par occuper des rôles importants dans le gouvernement de Ngouabi. À la fin de 1969, Ngouabi avait déclaré que le Congo était le premier gouvernement marxiste-léniniste d’Afrique, esquivant l’ambiguïté idéologique du premier gouvernement révolutionnaire.
Ce marxisme-léninisme, un amalgame des interprétations maoïstes et staliniennes du marxisme de l’époque, était le même cadre que celui dans lequel Cleaver et les Black Panthers avaient développé leurs propres orientations politiques aux États-Unis. Ainsi, une grande partie du langage et de l’iconographie du régime de Ngouabi semblait familière aux visiteurs. L’appareil photo de Stephens capture des affiches et des pancartes sur lesquelles figurent des portraits de Guevara, Mao Zedong, Hô Chi Minh et Lénine. Ces images n’étaient pas spécifiques au nouveau tournant marxiste-léniniste du Congo – toutes ces images étaient courantes à Brazzaville, brandies dans les rues par les organisations de jeunesse depuis 1964. Mais elles constituaient un répertoire commun aux marxistes du tiers-monde, familier aux militants des deux côtés de l’Atlantique.
« Encore plus fiers de notre héritage »
Bien que tourné exclusivement au Congo, Congo Oyé s’adresse à un public noir américain. Dans la séquence d’ouverture – un bateau négrier et des images des Cleaver visitant un site mémoriel de l’époque de l’esclavage portugais –, Eldridge raconte avec romantisme le sentiment viscéral de retrouvailles qu’il a eu avec les gens qu’ils ont rencontrés sur la « terre de [leurs] pères » après « 400 ans d’esclavage à Babylone ». Cleaver fait référence au célèbre poème Heritage du poète de la Renaissance de Harlem2 Countee Cullen, dans lequel ce dernier demande : « Qu’est-ce que l’Afrique pour moi ? » Cleaver répond :
Au Congo, nous avons obtenu cette réponse par nous-mêmes. Nous marchions parmi les gens, nous nous mêlions à eux librement et nous leur parlions de notre situation commune, de notre histoire commune... C’était comme si nous étions rentrés chez nous après un long voyage, pour nous y retrouver nous-mêmes.
Et pourtant, l’intérêt des Panthers pour le Congo ne s’explique pas seulement par la nostalgie d’une patrie perdue. Cleaver avait plutôt le sentiment de faire revivre l’insistance de Malcolm X à concevoir la libération des Noirs comme une lutte mondiale. Il a donc commencé son pamphlet sur la révolution congolaise, publié peu après sa visite, par une section intitulée After Brother Malcolm. Selon Cleaver, Malcolm était celui qui avait « accompli la tâche historique de relier la lutte afro-américaine pour la libération nationale et les luttes révolutionnaires d’Afrique » grâce à ses voyages sur le continent, son amitié avec le révolutionnaire zanzibarien Abdulrahman Mohamed Babu et sa tentative de créer en 1965 l’Organisation de l’unité afro-américaine. Cleaver poursuit : « Lui, plus que quiconque, a élevé notre conscience à un niveau où nous sommes devenus encore plus fiers de l’Afrique, de nos ancêtres africains et de notre héritage. »
Mais la mort de Malcolm X, en 1965, a créé une division parmi les radicaux noirs américains – une division qu’Eldridge Cleaver pensait que la révolution au Congo pouvait résoudre. Pour lui, la mort de Malcolm en a conduit certains à embrasser la « culture africaine » tout en répudiant l’appel de Malcolm à une lutte armée et militante. En partie en réponse au glissement vers la droite du « nationalisme culturel », d’autres militants qui sont restés attachés à la stratégie de Malcolm dite du « nationalisme noir révolutionnaire » (y compris les Panthers) ont adopté une obsession pour « l’arme » et se sont éloignés de leur lien avec l’Afrique.
Une vision romantique de l’Afrique
Pour Cleaver, la révolution au Congo offrait la possibilité de résoudre ce clivage et de faire revivre la vision de Malcolm :
Le fait historique de l’existence d’une nation marxiste-léniniste en Afrique détruit tous les arguments soutenant la perpétuation de la contradiction entre les nationalistes noirs révolutionnaires et les nationalistes culturels, qui pendant plusieurs années a étouffé une quantité inestimable d’énergie révolutionnaire.
Au milieu de Congo Oyé, le spectateur entend Cleaver raconter le moment de cette prise de conscience.
Pourtant, une telle tâche historique était un lourd fardeau pour une petite nation africaine d’un peu plus de 1 million d’habitants. Dans le film, Jean-Baptiste Ikoko, un ancien militant des milices de jeunes devenu un leader du nouveau gouvernement congolais, hésite à faire du Congo le porte-drapeau de la libération mondiale des Noirs. Lorsqu’il évoque son séjour aux États-Unis en tant qu’étudiant, Ikoko est franc : bien trop de personnes qu’il y a rencontrées avaient une vision romantique de l’Afrique, qu’elles voyaient comme un territoire où les gens vivaient sans exploitation ni conflit de classe. « Ce n’est pas vrai », dit Ikoko à ses visiteurs, déplorant notamment l’exploitation des femmes congolaises. Pour Ikoko, il n’y avait rien de vertueux à célébrer des aspects de la « culture africaine » qui allaient à l’encontre des objectifs égalitaires et libérateurs de la révolution.
En outre, Ikoko a contesté toute idée selon laquelle la race ou la négritude serait une source naturelle de fierté ou d’unité : « Ce n’est pas le plus important. L’essentiel pour nous est de sortir de l’exploitation. » Dans le film, nous ne voyons ni n’entendons la réaction des Cleaver, mais les commentaires d’Ikoko ont compliqué la perception qu’ils avaient de la révolution. Comme l’affirme l’historienne Sarah Fila-Bakabadio3, Cleaver voyait le Congo qu’il voulait voir, comme un symbole prouvant la compatibilité de la fusion du nationalisme noir et du marxisme des Panthers. Le Congo devait selon lui être le lieu où une lutte proprement afro-américaine se connecterait organiquement au tiers-monde. Mais les dirigeants congolais étaient, en fin de compte, concentrés sur la construction d’un État-nation et non sur une révolution mondiale. Et, comme le suggèrent les commentaires d’Ikoko, « la race n’était pas le principal dénominateur de leur lutte ». Bien qu’Eldridge Cleaver ait espéré faire du Congo le nouveau foyer de la section internationale des Panthers, le gouvernement congolais avait d’autres priorités.
La révolution par les armes
L’adoration de Cleaver pour la militarisation de la révolution a également masqué des problèmes sous-jacents. Une grande partie des images de la seconde moitié du film se concentre sur l’« Armée du peuple » – le nouveau nom de l’armée nationale du Congo, qui était censé intégrer une approche socialiste dans la culture militaire. Le gouvernement étant désormais dirigé par un officier, Marien Ngouabi, il n’est pas surprenant que l’armée ait commencé à jouer un rôle important dans la politique. Stephens montre une pancarte du 1er mai qui en témoigne : « Sans une armée du peuple, le peuple n’aurait rien ». Le film capture également les chants d’appel souvent dirigés par Ngouabi lui-même et auxquels répondent les jeunes soldats : « À bas le néocolonialisme ! À bas l’impérialisme ! À bas le tribalisme ! Honneur au peuple ! »
La vision d’une nation noire souveraine dotée d’une armée nationale, dont les objectifs déclarés étaient la fin de l’impérialisme et le soutien aux classes inférieures, était extrêmement séduisante pour Cleaver – surtout à une époque où l’armée américaine avait étendu sa guerre en Asie du Sud-Est et défendait clairement le contraire. Le Congo offrait l’espoir qu’« un jour, raconte Cleaver, le peuple afro-américain aura aussi son fusil, son armée, et il sera libre ». Lorsqu’il demande au leader congolais Claude-Ernest Ndalla un message pour le peuple afro-américain, celui-ci répond :
La lutte que nous menons contre l’impérialisme américain au Laos, au Cambodge, au Congo, au Chili, au Vietnam, ces luttes n’ont pas – et ne peuvent pas avoir – le même impact que les luttes menées par les Afro-Américains contre l’impérialisme dans leur propre pays. Le combat des Afro-Américains doit se faire par la violence, la violence révolutionnaire, il faut répondre aux impérialistes par la violence révolutionnaire.
De l’appel aux armes de Ndalla, le film passe à un plan final de soldats congolais chantant une ode aux Black Panthers et à leur lutte. Célébrant la chute du pouvoir américain, les soldats chantent à propos des États-Unis : « Après avoir été dissimulée, la révolution est entrée dans sa maison. » Mais si les mots de Ndalla valident le point de vue d’Eldridge Cleaver sur la nécessité de la résistance armée, pour les dirigeants congolais, il ne fait aucun doute que les Noirs américains et les Congolais ont des luttes qui leur sont propres. Comme le souligne Fila-Bakabadio, dans son souhait urgent de solidarité mondiale, Cleaver a choisi de ne pas reconnaître à quel point son projet différait de celui du gouvernement congolais.
Un épisode aujourd’hui ravivé
Les visiteurs n’étaient probablement pas non plus au courant de la situation trouble du Congo. Ce que les Panthers n’ont pas pu voir au cours de leur bref séjour de trois semaines, c’est à quel point l’engagement rhétorique du régime militaire envers l’anti-impérialisme et le marxisme n’avait que peu de déclinaison dans la pratique. Cette situation a frustré deux des jeunes leaders congolais interviewés pour le film : Ikoko et Diawara. En février 1972 – moins d’un an après leur apparition dans Congo Oyé –, Ikoko, Diawara et d’autres anciens jeunes militants ont orchestré leur propre tentative de coup d’État, dont ils espéraient qu’elle serait accompagnée d’un soulèvement populaire à Brazzaville. Mais le soulèvement ne s’est jamais produit, et leur tentative a échoué. Ils se sont réfugiés dans les forêts situées à l’ouest de Brazzaville, où ils ont essayé de mettre sur pied une guérilla. Ils ont finalement été capturés et exécutés en 1973, sous les ordres de Ngouabi.
Aujourd’hui, l’intérêt pour Diawara, Ikoko et leurs compagnons rebelles est ravivé parmi les jeunes Congolais intéressés par des alternatives radicales au règne interminable du président Denis Sassou-N’Guesso. Il est important de noter que Congo Oyé offre les seuls enregistrements audio connus de ces révolutionnaires martyrs.
Bien que le film présente les principaux personnages du passé du Congo, ces derniers sont nettement moins nombreux que les plans de personnes non identifiées en public : des hommes écoutant de la rumba, des écoliers défilant, des femmes sur un marché, de jeunes soldats écoutant leurs commandants et des spectateurs s’efforçant de suivre le défilé du 1er mai 1971. Le film ne s’attarde pas longtemps sur une personne en particulier, passant rapidement à la suivante. Mais le parti pris de Stephens était clair : la révolution congolaise ne pouvait être comprise uniquement à travers les paroles des représentants du gouvernement. Congo Oyé présente au contraire la révolution – et le potentiel de solidarité de la diaspora africaine – comme étant l’œuvre de toutes sortes de personnes, et pas seulement des leaders les plus connus.
Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).
 Faire un don
Faire un don
Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.
1Sean L. Malloy, Out of Oakland. Black Panther Party Internationalism during the Cold War, Cornell University Press, 2017.
2La Renaissance de Harlem est un mouvement de renouveau de la culture afro-américaine, dans l’entre-deux-guerres, qui s’exprime à travers les arts mais surtout la littérature.
3Sarah Fila-Bakabadio, « Against the empire : the Black Panthers in Congo, insurgent cosmopolitanism and the fluidity of revolutions », African Identities, Volume 16, 2018.
4Sean L. Malloy, Out of Oakland. Black Panther Party Internationalism during the Cold War, Cornell University Press, 2017.
5La Renaissance de Harlem est un mouvement de renouveau de la culture afro-américaine, dans l’entre-deux-guerres, qui s’exprime à travers les arts mais surtout la littérature.
6Sarah Fila-Bakabadio, « Against the empire : the Black Panthers in Congo, insurgent cosmopolitanism and the fluidity of revolutions », African Identities, Volume 16, 2018.
